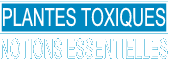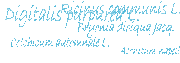|
|

|
Traitement des intoxications par contact cutanéomuqueux
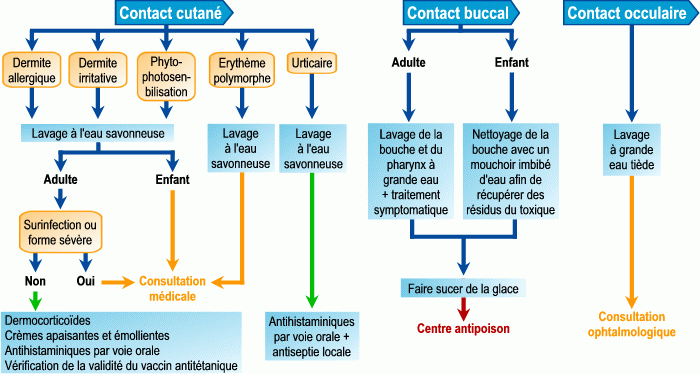
Dermite irritative
Définition
Inflammation et/ou lésion cutanée n'impliquant aucun mécanisme
immunologique.
Mécanismes
• Irritation mécanique :
L'irritation survient suite à un contact avec une plante pourvue d'épines,
de poils présents dans les feuilles, les tiges ou les organes de reproduction,
provocant l'apparition de microtraumatismes
• Irritation chimique :
L'irritation est consécutive à un contact avec diverses substances d'origine
végétale, notamment acides, glycosides, enzymes protéolytiques, oxalates de
calcium à propriétés caustiques ou vésicantes
Caractéristiques
La gravité des lésions dépend de la concentration de l'agent responsable, la durée du contact,
ainsi que l'intégrité du tissu
cutané.
Les lésions sont situées exclusivement au niveau des zones de
contact.
On distingue les dermites aiguës et les dermites chroniques ou cumulatives.
Clinique
• Dermites aiguës :
Ce type de dermite est caractérisé par une inflammation avec érythème, douleur,
œdème
accompagnée par des éruptions cutanées (macules, papules et/ou
vésicules) pouvant évoluer, lorsque l'agent irritant est très puissant,
vers des lésions d'allure
caustique se développant très rapidement (dans la demi-heure suivant
le contact) sous forme de bulles, de pustules, voire d'une nécrose
superficielle et d'ulcérations.
• Dermites chroniques :
Ce type de dermite, causée par un contact répété avec l'agent
irritant, entraîne à terme une sécheresse cutanée, la formation de
crevasses et une hyperkératose.
Topographie des lésions
Les lésions siègent uniquement au niveau des zones de
contact avec un risque de transport manuporté des agents irritants pouvant
causer une atteinte secondaire cutanéo-muqueuse (yeux, organes génitaux...).
Traitement
• Mesures générales :
Décontamination immédiate des zones exposées par lavage abondant à l'eau savonneuse
• Traitement local :
- Utilisation de pains dermatologiques ou de savons
surgras à visée antiseptique
- Dermocorticoïdes en cas de lésions modérées
- Crèmes ou pommades apaisantes et émollientes,
hydratantes en cas de sécheresse cutanée
• Traitement systémique :
- Corticothérapie par voie orale dans les formes sévères (Prednisone,
Prednisolone)
- Antihistaminiques H1 par voie orale à visée
anti-prurigineuse et/ou sédative
- Antibiothérapie par voie orale (Érythromycine)
indiquée en cas de surinfection bactérienne
Dermite allergique
Définition
Réaction anormale à un allergène végétal caractérisée
par des lésions d'eczéma, situées au niveau des zones de contact.
Mécanisme
Ce type de dermite est lié à un mécanisme immunologique impliquant
une réaction d'hypersensibilité retardée de type IV faisant intervenir les lymphocytes
T.
Caractéristiques
• La survenue de la réaction nécessite une sensibilisation
préalable (premier contact avec la plante)
• Les symptômes apparaissant entre 24 et 72 heures après le second contact
• Le déclenchement et l'intensité de la réaction ne dépendent pas de la
quantité de substance mise en contact
• Il existe un risque de sensibilisation croisée avec d'autres plantes
Clinique
On distingue trois types de dermite allergique de
contact :
• type eczéma de contact :
- Phase initiale érythémato-œdémateuse, associée à un prurit important
- Phase vésiculeuse (apparition de vésicules au niveau de la zone érythémateuse)
- Phase suintante : rupture des vésicules (formation de micro-ulcérations)
avec un risque important de surinfection bactérienne
- Phase croûteuse et kératosique
- Desquamation, épiderme rosé, puis aspect normal
• Dermite allergique sous-unguéale ("Tulip fingers") :
- Suite à contact avec des bulbes de tulipes
- Hyperkératose sous et péri-unguéale
- Évolution possible vers un granulome inflammatoire
• Dermite allergique de contact aéroportée :
- Aspect d'une photophytodermatose lichénifiée
- Suite à contact avec les pollens des Astéracées
Topographie
• Localisations initiales : mains, avant-bras ou jambes
• Extension possible au delà de la zone de contact d'origine
• Transport manuporté de l'allergène possible, pouvant
entraîner une atteinte secondaire cutanéo-muqueuse
Traitement
• Mesures générales :
Décontamination immédiate des zones exposées par lavage abondant à l'eau savonneuse
• Traitement local :
- Utilisation de pains dermatologiques ou de savons
surgras à visée antiseptique
- Dermocorticoïdes en cas de lésions modérées
- Crèmes ou pommades apaisantes et émollientes,
hydratantes en cas de sécheresse cutanée
• Traitement systémique :
- Corticothérapie par voie orale dans les formes sévères (Prednisone,
Prednisolone)
- Antihistaminiques H1 par voie orale à visée
anti-prurigineuse et/ou sédative
- Antibiothérapie par voie orale (Érythromycine)
indiquée en cas de surinfection bactérienne
Érythème polymorphe
Définition
Éruption caractérisée par des éléments érythémateux
papulo-œdémateux, vésiculo-bulleux, dont certains ont une disposition en
"cocarde", siégeant exclusivement au niveau des zones de contact avec
la plante.
Clinique
Aspect caractéristique des lésions disposées en "cocarde",
mais pouvant avoir des
aspects différents : papules, vésicules, bulles
La lésion typique :
• est arrondie, étendue sur 1 à 2 centimètres de
diamètre
• présente un centre cyanotique ou purpurique, bordé d'une zone érythémateuse
Traitement
• Traitement local : soins antiseptiques locaux quotidiens
• Traitement général : corticothérapie par voie orale
parfois préconisée (Prednisone : 0,5 mg/kg/jour), à initier dès le début
des lésions
Phytophotodermatose
Définition
Réaction cutanée exagérée lors de
l'exposition au soleil, à la suite d'un contact avec une plante contenant le
plus souvent des furocoumarines (bergaptènes,
psoralènes, xanthotoxines).
Mécanisme
Le mécanisme de la toxicité repose sur l'existence d'un contact de la peau avec une substance végétale ayant
acquis un pouvoir toxique après irradiation par les rayons ultraviolets. On
distingue :
• Réaction phototoxique :
C'est la réaction la plus fréquente. Non immunologique, elle correspond à une
réaction physiologique, favorisée par l'humidité. Elle survient dès le premier contact
et reste strictement localisée à la zone cutanée
en contact avec la plante et ayant été exposée à la lumière.
• Réaction photoallergique :
Cette réaction exceptionnelle fait intervenir un mécanisme immuno-allergique
(hypersensibilisation retardée de type IV) où l'antigène provient de à la transformation de la substance
végétale en cause, par irradiation lumineuse, en photoallergène
Clinique
• Réaction phototoxique :
Elle présente un aspect érythémateux, accompagné éventuellement de
vésicules
L'éruption se superpose aux contours de la plante responsable et aux zones
exposées au rayonnement UV, et ce dans les 24 - 72
heures après contact et exposition solaire.
• Réaction photoallergique :
L'aspect est très variable : urticaire, eczéma, aspect lichénifié,
purpurique...
Les lésions, qui apparaissent environ 48 heures après
l'exposition, sont au départ limitées aux
parties découvertes mais peuvent s'étendre aux zones protégées
Traitement
• Mesures générales :
Décontamination immédiate des zones exposées par lavage abondant à l'eau savonneuse
• Traitement local :
- Dermocorticoïdes en cas de lésions modérées
- Crèmes ou pommades apaisantes et émollientes,
hydratantes en cas de sécheresse cutanée
• Traitement systémique :
- Corticothérapie par voie orale dans les formes sévères (Prednisone,
Prednisolone)
- Antihistaminiques H1 par voie orale à visée
anti-prurigineuse et/ou sédative
- Antibiothérapie par voie orale (Érythromycine)
indiquée en cas de surinfection bactérienne
Urticaire de contact
Définition
Affection cutanée aiguë caractérisée par un érythème, témoignant
d'un œdème papillaire, souvent très prurigineux.
Mécanisme
• Mécanisme immunologique :
correspondant à une réaction d'hypersensibilité de type I
• Mécanisme non immunologique :
correspondant alors à une libération d'histamine sous l'action d'une
substance dite "histamino-libératrice" (exemple : acide
cinnamique pour le baume du Pérou)
Clinique
Présence de papules œdémateuses, très prurigineuses
mais transitoires.
Diagnostic
Basé sur l'aspect des lésions et confirmé si
nécessaire par des tests épicutanés.
Traitement
Antihistaminiques H1 par voie orale à visée antiprurigineuse et/ou
sédative
|
|
|
Références bibliographiques
BISMUTH C., 2000. Toxicologie clinique. Éd. Médecine-Sciences - Flammarion.
BLAMEY M., GREY-WILSON C., 1991. La flore d'Europe occidentale. Éd. Arthaud.
BOUDOU-SEBASTIAN C., 2003. Baies et plantes toxiques. Le
moniteur des pharmacies et des laboratoires, cahier II du n°2490.
BOURBIGOT P., 1984. Contribution à l'étude des intoxications par les plantes à
baies ou à fruits bacciformes rouges. Thèse Pharmacie, Lyon I.
BROSSE J., 1995. Les fruits. Bibliothèque de l'image.
BRUNETON J., 2001. Plantes toxiques. Végétaux dangereux pour l'Homme et les
animaux. Éd. Tec et Doc et EMI.
CAJAT M. C., 1992. Plantes ornementales toxiques et intoxications dans la région
de Clermont-Ferrand : cas recensés par le CAP de 1988 à 1990 ; risques pour les
jeunes enfants : enquête réalisée sur les aires de jeu des écoles maternelles.
Thèse Pharmacie, Clermont I.
COUPLAN F., STYNER E., 1994. Guide des plantes comestibles et toxiques. Éd.
Delachaux et Niestlé.
DÄHNCKE R. M., DÄHNCKE
S., 1981. Les baies. Comment déterminer correctement les baies comestibles et
les baies toxiques. Miniguide Nathan.
DEBELMAS A. M., DELAVEAU P., 1983. Guide des plantes dangereuses. Éd. Maloine.
DELAVEAU P., 1974. Plantes agressives et poisons végétaux. Éd. Horizons de
France.
DESCOTES J., TESTUD F., FRANTZ P., 1992. Les urgences en toxicologie. Baies
toxiques (505-511). Autres plantes toxiques (513-523). Éd. Maloine.
ENGEL F., GUILLEMAIN J., 2003. Plantes irritatives et allergisantes
d'appartements et de jardins. Éd. Institut Klorane.
FOURASTE I., 2002. Fruits charnus sauvages et des jardins. Éd. Institut Klorane.
FOURASTE I., 2001. Plantes toxiques sauvages et horticoles. Éd. Institut Klorane.
FROHNE D., PFÄNDER J., 2002. A colour atlas of
poisonous plants. Manson Publishing, Londres.
JEAN-BLAIN C., GRISVARD M., 1973. Plantes vénéneuses. Toxicologie. La Maison
Rustique, Paris.
LAUX H. E. (et GUEDES M.), 1985. Baies et fruits dans nos bois et jardins. Éd.
Bordas.
MEYER F., 1989. Toxicité des baies et des fruits bacciformes. Quinze ans
d'expérience du centre antipoisons de Lyon. Thèse Médecine, Lyon I.
MONDOLOT-COSSON L., 1998. Les plantes toxiques. Le moniteur des pharmacies et
des laboratoires, cahier pratique du n°2259.
Phytoma - La défense des végétaux n°572., 1999. Toxicité des baies en espaces
verts.
Phytoma - La défense des végétaux n°517., 1999. Principales plantes ornementales
à baies toxiques.
REYNAUD J., 2002. La flore du pharmacien. Éd. Tec et Doc et EMI.
SPOERKE D. G. Jr., SMOLINSKE S. C., 1990. Toxicity of houseplants. CRC Presse,
Boston.
THIEVON P. 1992. Développement et première validation d'un système informatique
d'identification des baies. Thèse médecine, Lyon I.
TOUATI A., 1985. Plantes toxiques ornementales. Thèse Pharmacie, Rennes.
TROTIN F., 1975. Plantes toxiques. Diagnose et effets. Un problème de
l'officine. Bulletin de la Société de Pharmacie de Lille n°31 (79-95).
VERMARE D., 1986. Le pouvoir nocif des plantes d'ornement. Thèse Médecine, Lyon
I
|
|
|
|