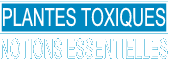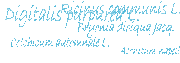|
|

|
Les troubles induits par l'ingestion
Suite à l'absorption d'une plante toxique, le sujet présente plus ou moins
rapidement des troubles digestifs communs, notamment nausées et vomissements
associés à une diarrhée violente visant à éliminer le toxique en
cause. On constate également des douleurs abdominales ou des coliques liées à
l'accélération du transit intestinal. Ces troubles sont parfois plus sérieux
avec présence de sang dans les selles ou les vomissements.
En l'absence de prise en charge adéquate, ces troubles peuvent évoluer vers
une déshydratation importante, accompagnée de pertes potassiques
avec risque d'hypovolémie et de collapsus.
Outre cet impact sur le plan digestif, d'autres manifestations plus spécifiques
peuvent survenir avec notamment des troubles au niveau cardiaque, rénal,
respiratoire, neurologique, hépatique...
Appareil digestif
• Troubles induits par contact avec le tube digestif
Le fait de porter à la bouche des plantes vésicantes,
contenant généralement un latex irritant, une résine ou des cristaux
d'oxalate de calcium entraîne rapidement des lésions irritatives,
accompagnées d'œdèmes et parfois de phlyctènes au niveau laryngé
et digestif si la substance a été avalée. Ces troubles sont induits par
ingestion ou contact avec des plantes comme le Dieffenbachia, le Poinsettia,
l'Arum, l'Euphorbe, le Daphné ou encore le Philodendron.
• Modification de la salivation
Les Solanacées à alcaloïdes parasympatholytiques (anticholinergiques) comme
la Belladone, la Jusquiame et le Datura entraînent une sécheresse buccale
caractéristique.
Un certain nombre de plantes à saponosides, ainsi que la Ciguë, le
Colchique, le Cytise, le Daphné, le Dieffenbachia et le Vératre provoquent
une hypersalivation (sialorrhée).
• Nausées et vomissements
Les nausées et vomissements surviennent de manière presque systématique
lors d'une intoxication.
• Diarrhées
Les diarrhées sont également quasiment toujours présentes et accompagnées
ou non d'hémorragie.
Système nerveux central
• Mydriase (dilatation de la pupille)
On observe une dilatation de la pupille lors d'une intoxication par les
Solanacées à alcaloïdes parasympatholytiques (Belladone, Datura,
Jusquiame...) ainsi que suite à l'ingestion de graines d'If et d'autres
plantes (Glycine, Euphorbes).
• Troubles de l'accommodation visuelle
Ils surviennent avec les mêmes Solanacées que précédemment ainsi qu'avec
le Vératre.
• Céphalées (maux de tête)
Les Solanacées à solanines (Morelle noire, Douce-amère, Pommier d'amour),
les plantes cardiotoxiques (Muguet, Fusain, Laurier-rose, Digitales,
Hellébore, Delphinium, Aconit) peuvent entraîner une céphalée plus
ou moins marquée.
• Paresthésies (troubles de la perception des
stimuli cutanés associés éventuellement à des douleurs plus ou moins
marquées)
Aconit et Vératre entraînent des troubles de cette nature.
• Convulsions
Tremblements et convulsions peuvent survenir au cours d'une intoxication par
les végétaux cyanogénétiques (Rosacées dont Laurier-cerise, certaines
Fabacées...), par l'Aconit ainsi que par diverses Apiacées aquatiques
(Grande ciguë, Ciguë aquatique...) qui entraînent en pratique une anoxie du
système nerveux.
• Délire
Lié à une intoxication grave par diverses Solanacées dont la Belladone mais
aussi par l'Actée en épi ou encore le Lierre grimpant.
• Coma
Vératre, plantes à oxalates (Dieffenbachia, Philodendron, Yucca), plantes à
lectines (Robinier, Cytise, Ricin...) peuvent entraîner un état comateux
plus ou moins marqué.
• Hyperthermie
Une augmentation de la température peut se manifester au cours d'intoxication
massive par les Solanacées (Belladone, Lyciet...).
Appareil respiratoire
• Dyspnée
Des troubles respiratoires surviennent lors d'une intoxication par les plantes cyanogénétiques mais aussi par l'Aconit ou les Solanacées parasympatholytiques.
Appareil cardio-vasculaire
• Troubles du rythme cardiaque
Les Solanacées à alcaloïdes parasympatholytiques, l'Éphédra, le Tabac accélèrent
le rythme cardiaque (tachycardie) tandis que le Vératre, l'Aconit, les
plantes cardiotoxiques (Muguet, Fusain, Laurier-rose, Digitales,
Hellébore, Delphinium, Aconit) causent une bradycardie (ralentissement du
rythme) associée à une arythmie.
• Hypertension
Une augmentation de la tension artérielle peut être induite par une
consommation excessive de Réglisse ou de ses extraits.
Appareil urinaire
Une quantité importante de plantes est à même d'engendrer des
troubles urinaires plus ou moins importants, pouvant aller d'une simple
irritation passagère (Douce-amère, Genièvre, plantes à saponines...)
jusqu'à une néphrite grave (plantes chinoises au cours de régime
amaigrissants, plantes à lectines...).
Lectines : Jequirity, Robinier, Lupin, Cytise, Ricin,
Croton
Acide aminé soufré (acide djenkolique) : Pithecolobium
lobatum
Acide oxalique : Rhubarbe, Rumex
Glucoalcaloïdes de type solanines : Morelle noire, Douce-amère, Pommier
d'amour, Pomme de terre
Huile essentielle : Genièvre
Saponosides : Saponaire et plantes apparentées
Divers principes actifs mal définis : If, Mercuriales, Anémones,
Renoncules, Hellébores, Aconit, Aristolochia fangchi, Stephania
tetrandra... |
Plantes et substances végétales néphrotoxiques
Troubles atropiniques ou anticholinergiques
Les Solanacées à alcaloïdes parasympatholytiques (noyau tropane) parmi
lesquelles on trouve la Belladone, le Datura et la Jusquiame induisent une quantité
importante de troubles.
On constate ainsi sécheresse buccale, constipation, mydriase (dilatation de la
pupille), troubles de l'accommodation visuelle, diminution des secrétions
lacrymales et cutanées, augmentation de la pression intraoculaire avec un
risque de glaucome, tachycardie (augmentation du rythme cardiaque) et rétention
urinaire.
Lors d'une intoxication massive, les troubles peuvent évoluer avec excitation,
confusion mentale, hallucinations, hyperthermie, dépression respiratoire et
coma.
|
|
|
Références bibliographiques
BISMUTH C., 2000. Toxicologie clinique. Éd. Médecine-Sciences - Flammarion.
BLAMEY M., GREY-WILSON C., 1991. La flore d'Europe occidentale. Éd. Arthaud.
BOUDOU-SEBASTIAN C., 2003. Baies et plantes toxiques. Le
moniteur des pharmacies et des laboratoires, cahier II du n°2490.
BOURBIGOT P., 1984. Contribution à l'étude des intoxications par les plantes à
baies ou à fruits bacciformes rouges. Thèse Pharmacie, Lyon I.
BROSSE J., 1995. Les fruits. Bibliothèque de l'image.
BRUNETON J., 2001. Plantes toxiques. Végétaux dangereux pour l'Homme et les
animaux. Éd. Tec et Doc et EMI.
CAJAT M. C., 1992. Plantes ornementales toxiques et intoxications dans la région
de Clermont-Ferrand : cas recensés par le CAP de 1988 à 1990 ; risques pour les
jeunes enfants : enquête réalisée sur les aires de jeu des écoles maternelles.
Thèse Pharmacie, Clermont I.
COUPLAN F., STYNER E., 1994. Guide des plantes comestibles et toxiques. Éd.
Delachaux et Niestlé.
DÄHNCKE R. M., DÄHNCKE
S., 1981. Les baies. Comment déterminer correctement les baies comestibles et
les baies toxiques. Miniguide Nathan.
DEBELMAS A. M., DELAVEAU P., 1983. Guide des plantes dangereuses. Éd. Maloine.
DELAVEAU P., 1974. Plantes agressives et poisons végétaux. Éd. Horizons de
France.
DESCOTES J., TESTUD F., FRANTZ P., 1992. Les urgences en toxicologie. Baies
toxiques (505-511). Autres plantes toxiques (513-523). Éd. Maloine.
ENGEL F., GUILLEMAIN J., 2003. Plantes irritatives et allergisantes
d'appartements et de jardins. Éd. Institut Klorane.
FOURASTE I., 2002. Fruits charnus sauvages et des jardins. Éd. Institut Klorane.
FOURASTE I., 2001. Plantes toxiques sauvages et horticoles. Éd. Institut Klorane.
FROHNE D., PFÄNDER J., 2002. A colour atlas of
poisonous plants. Manson Publishing, Londres.
JEAN-BLAIN C., GRISVARD M., 1973. Plantes vénéneuses. Toxicologie. La Maison
Rustique, Paris.
LAUX H. E. (et GUEDES M.), 1985. Baies et fruits dans nos bois et jardins. Éd.
Bordas.
MEYER F., 1989. Toxicité des baies et des fruits bacciformes. Quinze ans
d'expérience du centre antipoisons de Lyon. Thèse Médecine, Lyon I.
MONDOLOT-COSSON L., 1998. Les plantes toxiques. Le moniteur des pharmacies et
des laboratoires, cahier pratique du n°2259.
Phytoma - La défense des végétaux n°572., 1999. Toxicité des baies en espaces
verts.
Phytoma - La défense des végétaux n°517., 1999. Principales plantes ornementales
à baies toxiques.
REYNAUD J., 2002. La flore du pharmacien. Éd. Tec et Doc et EMI.
SPOERKE D. G. Jr., SMOLINSKE S. C., 1990. Toxicity of houseplants. CRC Presse,
Boston.
THIEVON P. 1992. Développement et première validation d'un système informatique
d'identification des baies. Thèse médecine, Lyon I.
TOUATI A., 1985. Plantes toxiques ornementales. Thèse Pharmacie, Rennes.
TROTIN F., 1975. Plantes toxiques. Diagnose et effets. Un problème de
l'officine. Bulletin de la Société de Pharmacie de Lille n°31 (79-95).
VERMARE D., 1986. Le pouvoir nocif des plantes d'ornement. Thèse Médecine, Lyon
I
|
|
|
|