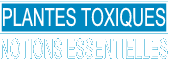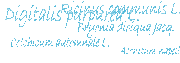|
|

|
Toxicité des plantes : généralités
Fréquence et gravité
Chaque année, les centres antipoison enregistrent environ 6 % d'appels
impliquant une intoxication par les végétaux. Généralement, il s'agit d'une
intoxication accidentelle liée à l'ingestion par des enfants de moins de cinq
ans de baies ou de fragments provenant de plantes d'appartement.
On rencontre également des intoxications consécutives à la confusion entre
une plante comestible et une plante toxique.
Dans la plupart des cas, ces intoxications n'ont pas de conséquences sérieuses
bien que les effets rencontrés varient selon l'individu (age, sexe, état
physiologique) et en fonction des circonstances de l'intoxication (partie
incriminée, moment, voie, quantité...).
Il est à noter que la toxicité réelle des baies et des plantes toxiques
est souvent sujette à controverse entre différents auteurs.
Les différents types d'intoxication
Intoxication accidentelle
• Ingestion de baies ou de fragments végétaux chez l'enfant en
bas age conduisant à un intoxication généralement peu grave étant donné
la faible quantité ingérée.
• Confusion alimentaire entraînant une intoxication dont le
pronostic peut s'avérer beaucoup plus réservé étant donné la quantité
potentiellement importante de végétaux consommés (confusion entre Aconit et
Navet, entre Vératre et Gentiane...).
• Liée à la projection de sève ou de suc au niveau oculaire
(Caoutchouc...).
• Induite par un contact cutanéomuqueux (latex de la Chélidoine).
Intoxication volontaire
• Intoxication aiguë par empoisonnement ou suicide dont les
conséquences, potentiellement très graves, varient selon la nature et la
quantité de toxique ingérée.
• Intoxication chronique par abus ou mésusage répétitif d'une
plante plus ou moins toxique.
Les principaux types de toxicité
Toxicité aiguë
• Toxicité digestive : nausées, vomissements, diarrhées,
douleurs abdominales, coliques.
• Toxicité extradigestive : neurologique, respiratoire ou
cardiovasculaire.
• Toxicité par contact cutanéomuqueux : érythème polymorphe,
dermites, urticaire de contact, phytodermatose.
Toxicité chronique
• Hépatotoxicité : forme aiguë avec douleurs abdominales,
nausées, vomissements, hépatomégalie et ascite ; forme subaiguë avec
hépatomégalie et ascite ; forme chronique aboutissant à une cirrhose.
• L'utilisation de certaines plantes chinoise au cours de régimes
amaigrissants (Aristolochia fangchi et Stephania tetrandra) peut
entraîner une fibrose rénale interstitielle après 5 à 20 mois
d'utilisation.
Les organes végétaux incriminés
Une plante est rarement toxique dans sa totalité. Ainsi, un organe d'un
végétal peut être toxique tandis qu'un autre organe de la même plante peut
être comestible. Les intoxications sont donc également dépendantes de
l'organe végétal en cause.
Fruits (notamment baies)
• On rencontre deux modalités
d'intoxications impliquant des baies :
- confusion avec des baies comestibles ;
- ingestion par des enfants au cours de dînettes improvisées.
Le degré de gravité de l'intoxication est fonction de la toxicité des baies, qui dépend elle-même de divers facteurs comme le degré de
maturation, les conditions météorologiques, la zone géographique ou encore
la nature du sol. De plus, il est souvent difficile de déterminer
précisément la quantité de baies consommées. • La toxicité varie
selon la plante incriminée :
- baies très toxiques : If, Laurier-cerise, Belladone, Morelle noire,
Pommier d'amour, Douce-amère, Muguet, Gui... Ces baies peuvent en cas de
consommation importante entraîner des troubles respiratoires,
cardiovasculaires, une altération de la conscience pouvant évoluer vers le
coma, voire la mort.
- baies toxiques entraînant des symptômes équivalents mais
généralement atténués : Arum, Alkékenge, Sceau-de-Salomon, Chèvrefeuille,
Nerprun, Bourdaine, Fusain...
- baies peu toxiques à troubles plus mineurs, essentiellement digestifs mais
nécessitant néanmoins une surveillance pour éviter toute complication
potentielle comme une déshydratation, une hypotension, des troubles du rythme
ou encore une atteinte rénale : Lierre, Tamier, Marronnier d'Inde, Fragon, Troène, Sureau, Vigne vierge, Buisson ardent, Parisette, Ricin... Racines,
bulbes et rhizomes
Ces intoxications sont pratiquement toujours liées
à une confusion avec une plante comestible : Gentiane et Vératre, Carotte
sauvage et Ciguë, Alliacées comestibles (Oignon, Ail, Échalote) et bulbes
d'Amaryllidacées (Narcisse, Jonquille)... En fonction de la quantité
consommée, potentiellement importante, l'intoxication peut être sévère et
toucher en outre toute une famille. Feuilles et tiges
Les feuilles sont généralement à l'origine d'intoxications chez les enfants qui
les mâchonnent mais elles peuvent également être la cause d'une confusion
alimentaire (préparation de soupe à partir de feuilles de Datura).
On enregistre aussi des cas de toxicité cutanéomuqueuse, notamment avec :
Lierre, Arum, Dieffenbachia et avec de nombreuses Renonculacées... Fleurs
Les fleurs entraînent souvent des confusions alimentaires, comme entre l'Acacia
et le Cytise, le Genêt à balai et le Genêt d'Espagne... Graines
Elles induisent des intoxications lors de
la consommation par des enfants mais également par confusion avec
des graines comestibles ou encore par contamination accidentelle
d'une récolte par des graines toxiques (récolte du sarrasin
contaminée par des graines de Datura).
Les principes actifs responsables de la toxicité
Les principes
actifs responsables de la toxicité sont déterminés par diverses méthodes
analytiques comme la colorimétrie, la chromatographie en phase gazeuse (CPG),
la chromatographie sur couche mince (CCM), la chromatographie liquide haute
performance (CLHP), la spectrométrie de masse ou encore les ultraviolets. On
peut ainsi envisager la toxicité d'une plante en fonction des principes actifs
toxiques présents.
| Principe toxique |
Plantes concernées |
Type de toxicité |
Symptômes |
| Ingestion faible ou moyenne |
Ingestion massive |
| Hétérosides |
Stéroïdiques |
Muguet, Fusain, Laurier-rose, Digitale, Hellébore |
Cardiotoxique |
Troubles digestifs mineurs, asthénie, agitation |
Troubles cardiaques et neurologiques |
| Génine triterpénique |
Bryone |
Purgatif drastique |
Diarrhées, asthénie, agitation |
Troubles cardiaques et neurologiques |
| Dérivés anthracéniques |
Bourdaine, Nerprun |
Purgatif drastique |
Diarrhées |
Déshydratation |
| Alcaloïdes |
Stéroïdiques |
Vératre, Buis, Douce-amère, Pommier d'amour |
Émétocathartique |
Diarrhées, vomissements |
| Dérivés de phénanthridine |
Jonquille, Perce-neige, Chélidoine |
Émétocathartique |
Gastro-entérite |
| Noyau tropolone |
Colchique |
Émétocathartique |
Gastro-entérite |
Baisse des facteurs de la coagulation, aplasie
médullaire,
syndrome neurologique déficitaire |
| Diterpénique |
Aconit, Delphinium |
Cardiotoxicité |
Paresthésie buccolabiales, hypersalivation,
troubles digestifs (signes généraux : pâleur, hypersudation,
hypothermie, frissons), troubles neurologiques, cardiaques, dépression
respiratoire |
| Dérivés quinolizidiques |
Genêt d'Espagne, Cytise, Lupin |
Poison ganglionnaire |
Brûlure buccale, troubles digestifs, cardiaque |
Convulsions, collapsus, arythmie |
| Taxine |
If |
Poison nerveux |
Moins de 3 graines : souvent asymptomatique |
Troubles digestifs, neurologiques, dépression respiratoire,
hypotension artérielle, collapsus, asystolie |
| Pipéridiniques |
Grande ciguë |
Poison respiratoire |
Troubles digestifs, signes généraux |
Paralysie des muscles respiratoires, insuffisance
rénale |
| Dérivés tropane |
Belladone, Datura, Jusquiame |
Parasympatholytique |
Syndrome anticholinergique |
Convulsions, coma calme, dépression cardiorespiratoire |
| Saponosides |
Parisette, Tamier, Sceau-de-Salomon, Phytolacca,
Marronnier d'Inde, Chèvrefeuille, Houx, Arum, Troène, Morelle noire |
Irritant, hémolytique |
Troubles digestifs, dermite irritative |
Troubles cardiovasculaires, troubles neurologiques |
| Huiles essentielles |
Thuya |
Ocytocique, irritant |
Dermite irritative |
| Résines, latex |
Dieffenbachia, Poinsettia, Euphorbe |
Irritant |
Irritation buccopharyngée (voire œdème),
dermite irritative, conjonctivite (voire kératite) |
| Lactones |
Anémone, Clématite, Renoncules (famille) |
Vésicant |
Œsophagite, dépression respiratoire,
dermite irritative, conjonctivite, blépharite |
| Oxalates de calcium |
Dieffenbachia, Philodendron, Yucca |
Irritant |
Inflammation buccopharyngée, dermite
irritative,
conjonctivite |
| Toxine protéique |
Ricin, Robinier, Ciguë vireuse, Œnanthe safranée |
Troubles digestifs |
Irritation buccopharyngée, troubles digestifs,
neurologiques, dermite irritative, urticaire |
Convulsions, collapsus |
| Dérivés coumariniques |
Grande berce, Panais |
Photosensibilisation |
Éruptions érythémateuses 24 à 72 heures après
contact avec la plante et exposition au soleil |
|
|
|
Références bibliographiques
BISMUTH C., 2000. Toxicologie clinique. Éd. Médecine-Sciences - Flammarion.
BLAMEY M., GREY-WILSON C., 1991. La flore d'Europe occidentale. Éd. Arthaud.
BOUDOU-SEBASTIAN C., 2003. Baies et plantes toxiques. Le
moniteur des pharmacies et des laboratoires, cahier II du n°2490.
BOURBIGOT P., 1984. Contribution à l'étude des intoxications par les plantes à
baies ou à fruits bacciformes rouges. Thèse Pharmacie, Lyon I.
BROSSE J., 1995. Les fruits. Bibliothèque de l'image.
BRUNETON J., 2001. Plantes toxiques. Végétaux dangereux pour l'Homme et les
animaux. Éd. Tec et Doc et EMI.
CAJAT M. C., 1992. Plantes ornementales toxiques et intoxications dans la région
de Clermont-Ferrand : cas recensés par le CAP de 1988 à 1990 ; risques pour les
jeunes enfants : enquête réalisée sur les aires de jeu des écoles maternelles.
Thèse Pharmacie, Clermont I.
COUPLAN F., STYNER E., 1994. Guide des plantes comestibles et toxiques. Éd.
Delachaux et Niestlé.
DÄHNCKE R. M., DÄHNCKE
S., 1981. Les baies. Comment déterminer correctement les baies comestibles et
les baies toxiques. Miniguide Nathan.
DEBELMAS A. M., DELAVEAU P., 1983. Guide des plantes dangereuses. Éd. Maloine.
DELAVEAU P., 1974. Plantes agressives et poisons végétaux. Éd. Horizons de
France.
DESCOTES J., TESTUD F., FRANTZ P., 1992. Les urgences en toxicologie. Baies
toxiques (505-511). Autres plantes toxiques (513-523). Éd. Maloine.
ENGEL F., GUILLEMAIN J., 2003. Plantes irritatives et allergisantes
d'appartements et de jardins. Éd. Institut Klorane.
FOURASTE I., 2002. Fruits charnus sauvages et des jardins. Éd. Institut Klorane.
FOURASTE I., 2001. Plantes toxiques sauvages et horticoles. Éd. Institut Klorane.
FROHNE D., PFÄNDER J., 2002. A colour atlas of
poisonous plants. Manson Publishing, Londres.
JEAN-BLAIN C., GRISVARD M., 1973. Plantes vénéneuses. Toxicologie. La Maison
Rustique, Paris.
LAUX H. E. (et GUEDES M.), 1985. Baies et fruits dans nos bois et jardins. Éd.
Bordas.
MEYER F., 1989. Toxicité des baies et des fruits bacciformes. Quinze ans
d'expérience du centre antipoisons de Lyon. Thèse Médecine, Lyon I.
MONDOLOT-COSSON L., 1998. Les plantes toxiques. Le moniteur des pharmacies et
des laboratoires, cahier pratique du n°2259.
Phytoma - La défense des végétaux n°572., 1999. Toxicité des baies en espaces
verts.
Phytoma - La défense des végétaux n°517., 1999. Principales plantes ornementales
à baies toxiques.
REYNAUD J., 2002. La flore du pharmacien. Éd. Tec et Doc et EMI.
SPOERKE D. G. Jr., SMOLINSKE S. C., 1990. Toxicity of houseplants. CRC Presse,
Boston.
THIEVON P. 1992. Développement et première validation d'un système informatique
d'identification des baies. Thèse médecine, Lyon I.
TOUATI A., 1985. Plantes toxiques ornementales. Thèse Pharmacie, Rennes.
TROTIN F., 1975. Plantes toxiques. Diagnose et effets. Un problème de
l'officine. Bulletin de la Société de Pharmacie de Lille n°31 (79-95).
VERMARE D., 1986. Le pouvoir nocif des plantes d'ornement. Thèse Médecine, Lyon
I
|
|
|
|