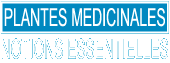Les tisanes
Définitions
Les plantes pour tisanes sont constituées exclusivement d'une ou plusieurs
drogues végétales destinées à des préparations aqueuses buvables par décoction,
infusion ou macération. La préparation est réalisée au moment de l'emploi.
Celles-ci n'exigent aucun dosage quantitatif précis par tasse ; elles peuvent
aussi renfermer des extraits de drogues totalement solubles (tisanes
instantanées). (Définition d'après la Pharmacopée européenne)
Les tisanes sont des préparations aqueuses de plantes médicinales entières ou de
parties de celles-ci, convenablement divisées pour être plus facilement
pénétrées par l'eau. Elles sont administrées à des fins thérapeutiques. Elles
peuvent encore servir de boisson aux malades ou de véhicule pour
l'administration de divers médicaments. Les tisanes sont obtenues par
macération, digestion, infusion ou décoction, dans des récipients couverts, en
utilisant de l'eau potable. (Définition d'après la Pharmacopée française)
Les tisanes
Les sachets-doses
La présentation des tisanes sous forme de sachets-doses est avantageuse à plus
d'un titre :
Le consommateur dispose aisément de la dose à priori exacte ; la fragmentation
élevée garantit une meilleure extraction des constituants (sauf dans le cas des
drogues à huiles essentielles) et le stockage n'entraîne pas de séparation des
principes actifs par sédimentation.
Le principal écueil concerne le degré de fragmentation de la drogue, provoquant
une perte d'efficacité des drogues à huiles essentielles, par destruction des
poils sécréteurs et des poches sécrétrices. En officine, les exigences de la
pharmacopée et de l'AMM imposent une qualité garantie par le respect des normes
suivantes :
• matière première de départ répondant aux exigences de la pharmacopée ;
• sachets double épaisseur non collés avec fil et marquage permettant
l'identification ;
• protection des arômes et vis-à-vis de l'humidité ;
• date de fabrication ou plutôt de péremption bien en évidence.
Les tisanes instantanées
Les tisanes existent aussi sous forme instantanée permettant une préparation
rapide par une simple dissolution du produit dans l'eau chaude, sans
"macération" ni filtration. La composition est en outre uniforme et constante.
Ces tisanes sont généralement fabriquées par une extraction totale de la drogue
par un mélange eau-éthanol, afin de les enrichir en certains constituants
actifs.
Les atomisats
La solution extractive initiale est pulvérisée sous forme de fines gouttelettes
dans un courant d'air chaud. Il peut être nécessaire d'ajouter de faibles
quantités de polysaccharides étrangers à la drogue à l'atomisat obtenu. Les
huiles essentielles volatilisées peuvent être réintroduites, de préférence sous
forme microencapsulée.
Le produit final est une poudre facilement soluble dans l'eau, faible densité
mais relativement hygroscopique (attention au stockage).
Les tisanes en granulés
L'extrait fluide initial est pulvérisé sur du saccharose ou un autre
polysaccharide, puis séché par chauffage. La masse sèche obtenue est ensuite
fragmentée en granulés par un broyeur adapté. Les granulés obtenus sont aisément
solubles dans l'eau et sont moins hygroscopiques que les atomisats. La
manipulation est facilitée et le goût est immédiatement sucré (il convient de
vérifier le type de polysaccharide utilisé).
La teneur en extrait présente dans les tisanes en granulés est généralement bien
inférieure à celle des tisanes instantanées à base d'atomisats (2 à 3 % contre
20 % en moyenne).
L'infusion
L'infusion consiste à recouvrir la drogue fragmentée d'eau bouillante. Il existe
autant de modes opératoires que d'ouvrages de phytothérapie traitant du sujet.
Les paramètres suivants doivent entrer en ligne de compte :
• la quantité de drogue pour une dose unitaire et la quantité de liquide ;
• le degré de fragmentation de la drogue ;
• la méthode d'extraction (température, temps de contact...).
Quantité de drogue et de liquide
La dose unitaire de drogue repose en général sur l'expérience mais peut parfois
se calculer à partir de l'activité des constituants. Néanmoins, étant donné que
de nombreuses drogues renferment des substances faiblement actives et atoxiques
et que la marge thérapeutique est très large, les dépassements de posologies ne
jouent qu'un rôle mineur (il existe néanmoins des exceptions comme les fleurs
d'arnica, les racines de réglisse...).
Les tisanes doivent être préparées extemporanément et éventuellement filtrées
(bouillon blanc, bruyère, reine des prés). La Pharmacopée française fait mention
dans un tableau des protocoles d'obtention des tisanes (décoction, digestion,
infusion, macération) pour chacune des drogues, le mode d'obtention et la durée
d'obtention (en min), la concentration de la drogue utilisée (en g/l) et la dose
quotidienne usuelle.
Le degré de fragmentation de la drogue
La teneur en constituants de l'infusion est d'autant plus élevée que le degré de
fragmentation est important.
Les données suivantes sont données à titre indicatif :
• feuille, fleur, plante entière : coupe grossière ou moyenne (taille des
particules : environ 4 mm) ;
• bois, écorce, racine : coupe fine ou pulvérisation grossière (particules
d'environ 2.5 mm) ;
• fruit et graine : broyage ou pulvérisation grossière extemporanée (particules
d'environ 2 mm) ;
• drogues à alcaloïdes et à saponosides : particules d'environ 0.5 mm.
Il est à noter qu'au cours de la fragmentation les poils sécréteurs et les
poches sécrétrices sont endommagés, entraînant une volatilisation accélérée de
l'huile essentielle et induisant aussi des processus d'oxydation. Néanmoins,
l'huile essentielle de certaines drogues (fruits d'Apiacées) s'extrait très
difficilement de la drogue entière. Il convient alors de stocker ces drogues
sous forme entière et de fragmenter les doses unitaires extemporanément.
Les méthodes d'extraction
La méthode la plus utilisée en France est l'infusion.
Infusion
L'infusion consiste à verser sur la drogue de l'eau potable bouillante et à
laisser refroidir. L'infusion convient aux drogues fragiles et aux drogues
riches en huiles essentielles. (Définition d'après la Pharmacopée française)
En pratique, verser 150 à 250 ml d'eau bouillante sur la quantité de drogue
nécessaire dans un récipient en verre ou en porcelaine, recouvrir et
remuer périodiquement ; filtrer après 5-10 min. Ce procédé s'applique aux
feuilles, aux fleurs et aux parties aériennes ainsi qu'à certaines parties
corticales et aux racines fragmentées.
Décoction
La décoction consiste à maintenir la drogue avec de l'eau potable à ébullition
pendant une durée de 15 à 30 min. (Définition d'après la Pharmacopée française)
On ajoute donc la drogue à de l'eau froide puis le mélange est porté à
ébullition pendant la durée nécessaire et filtré après un bref repos. Cette
méthode est adaptée pour des drogues de consistance dure ou très dure (bois,
racines ou écorces), notamment celles renfermant des tanins.
Macération
La macération consiste à maintenir en contact la drogue avec de l'eau potable à
température ambiante pendant une durée de 30 min à 4 h. (Définition d'après la
Pharmacopée française)
Une filtration peut ensuite être réalisée et le macérat se consomme froid ou
peut également être chauffé. Ce mode de préparation convient bien aux drogues
mucilagineuses (racines de guimauve, graine de lin, lichen d'Islande...), et
permet en outre d'exclure certains constituants indésirables, moins solubles
dans l'eau froide (tanins des feuilles de busserole par exemple)
L'inconvénient principal de ce mode de préparation est le risque de
contamination bactérienne du produit final en l'absence d'ébullition.
Digestion
La digestion consiste à maintenir en contact la drogue avec de l'eau potable à
une température inférieure à celle de l'ébullition, mais supérieure à la
température ambiante pendant une durée de 1 h à 5 h. (Définition d'après la
Pharmacopée française)
Ce procédé n'est que très rarement utilisé en pratique (racine de polygala,
rhizome de valériane).
Aspects réglementaires des plantes médicinales
Les plantes médicinales de la liste des plantes médicinales de la Pharmacopée
française font partie du monopole pharmaceutique selon l'article L.4211-1/5° du
Code de la Santé Publique, sous réserve des dérogations établies par décret. Le
décret n° 79-480 du 15 juin 1979 libère 34 plantes qui peuvent être vendues en
l'état par tout public. La circulaire 346 du 2 juillet 1979 insiste sur le fait
que peuvent être considérées comme plantes médicinales, les plantes qui ont un
usage uniquement médicinal, à l'exception de tout usage alimentaire,
condimentaire ou hygiénique.
|