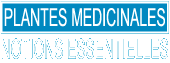Une qualité pharmaceutique indispensable
L'innocuité des médicaments est fondamentale. La qualité pharmaceutique se doit
en effet de garantir non seulement l'efficacité mais aussi l'absence de toxicité
dans des conditions normales d'utilisation. A cette fin, il est indispensable de
définir rigoureusement l'identité et la qualité de la matière première (ou
drogue) qui sert à la préparation de ces médicaments. Ceci nécessite de nombreux
contrôles qui permettent l'élaboration de fiches signalétiques concernant les
matières premières et de bulletins de contrôle libérant les lots de produits
finis. Une étude de stabilité complète l'ensemble.
Quelques définitions utiles
Matières premières
• Les produits d'origine végétale, issus du règne végétal, sont utilisés
comme matière première, en l'état ou après un procédé de production approprié,
dans les préparations pharmaceutiques. L'origine végétale du produit doit être
définie avec précision par la dénomination scientifique botanique selon les
règles linnéennes (genre, espèce, variété, auteur).
Les produits d'origine végétale utilisés à des fins thérapeutiques sont définis
comme des drogues végétales ou des préparations à base de drogues végétales.
• Les drogues végétales sont essentiellement des plantes, parties de plantes
ou algues, champignons, lichens, entiers, fragmentés ou coupés, utilisés en
l'état, soit le plus souvent sous forme desséchée, soit à l'état frais. Certains
exsudats n'ayant pas subi de traitement spécifiques sont également considérés
comme des drogues végétales. Les drogues végétales doivent être définies avec
précision par la dénomination scientifique selon le système à deux mots. Elles
sont obtenues à partir de plantes cultivées ou sauvages. Des conditions
appropriées de collecte, de culture, de récolte, de séchage, de fermentation et
de stockage sont essentielles pour garantir leur qualité. Elles sont identifiées
par leur description macroscopique, microscopique et par CCM notamment. Elles
satisfont aux exigences mentionnées dans les monographies individuelles de la
Pharmacopée européenne (définition, identification, essai, dosage).
• Les préparations à base de drogue(s) végétale(s) sont obtenues en
soumettant les drogues à des traitements comme l'extraction, la distillation,
l'expression, le fractionnement, la purification, la concentration ou la
fermentation. Ce sont notamment des teintures, des extraits, des huiles
essentielles, des huiles grasses, certains jus végétaux et certaines poudres.
Les composants isolés, chimiquement définis ou leur mélange, ne sont pas
considérés comme des préparations à base de drogue(s) végétale(s).
• Le principe actif : une drogue végétale en l'état ou sous forme de
préparation est considérée comme un principe actif dans sa totalité, que ses
composants ayant un effet thérapeutique soient connus ou non.
Médicaments à base de plantes
• Ce sont des médicaments dont les principes actifs sont exclusivement des
drogues végétales et/ou des préparations à base de drogue(s) végétale(s).
• Les composants à effets thérapeutiques connus sont des substances ou des
groupes de substances, définis chimiquement, dont la contribution à l'effet
thérapeutique d'une drogue végétale ou d'une préparation est connue.
• Les traceurs sont les composants d'une drogue végétale, définis
chimiquement et importants pour la réalisation des contrôles.
• Les témoins externes sont des substances, définies chimiquement, étrangères
à la drogue végétale considérée, mais qui présentent un intérêt pour la
réalisation des contrôles de qualité.
La dénomination scientifique
Le naturaliste Linné a défini cette nomenclature, qui permet de
caractériser chaque espèce par deux noms latins.
Le premier correspond au nom de genre, le second au nom d'espèce :
Ex. : Rosa canina et Rosa repens
correspondent à deux espèces du genre Rosa et habituellement confondues
sous le nom d'Églantier. Enfin, le nom d'espèce est suivi par le nom du
premier botaniste à l'avoir décrite, ce nom pouvant être abrégé (par ex. : L.,
pour Linné).
La sous-espèce ou la variété peuvent également être précisés. La famille est
généralement indiquée.
La précision de cette dénomination est fondamentale, et se complète par une
différentiation chimique pouvant intervenir à des niveaux botaniques très
variés :
• Au niveau de la famille : certaines familles botaniques font preuve d'une
grande homogénéité chimique : ainsi, les Lamiacées aromatiques renferment
presque toutes une huile essentielle ; les Gentianacées ou les Astéracées
présentent généralement des lactones terpéniques amères...
• Au niveau du genre : la totalité des espèces du genre Digitalis
renferme des hétérosides cardiotoniques ; l'ensemble des espèces du genre
Cassia contient des hétérosides anthraquinoniques à propriétés
laxatives...
• Au niveau de l'espèce : une composition chimique rigoureusement identique
entre deux espèce différentes est exceptionnelle ; c'est néanmoins le cas chez
les sénés.
• Au niveau de la variété : c'est généralement le cas des plantes à huiles
essentielles. La chimiotaxonomie est une discipline basée sur les relations
existant entre les caractères chimiques et les caractères botaniques.
La drogue
Les monographies des pharmacopées précisent la nature de l'organe utilisé,
généralement désigné par le terme de "drogue". Ainsi, si la totalité des organes
(feuille, fruit, racine) de la belladone (Atropa belladona L.) contient
des alcaloïdes, par contre, seule l'écorce de quinquina (Cinchona sp.),
renferme de la quinine. De plus, les composés synthétisés peuvent varier en
fonction de l'organe, d'où l'importance du choix de la drogue comme matière
première.
Le mode d'obtention et la récolte
Période de la récolte
Certaines études scientifiques, en rapport avec des notions de
chronobiologie, ont permis de définir le moment optimal de la récolte, afin de
garantir la qualité de la matière première. Ainsi, on préfère récolter :
• les racines durant le repos végétatif (automne, hiver) ;
• les parties aériennes, le plus souvent au moment de la floraison ;
• les feuilles, juste avant la floraison ;
• les fleurs à leur plein épanouissement, voire en bouton ;
• les graines, lorsqu'elles ont perdu la majeure partie de leur humidité
naturelle.
Nature la dessiccation
Afin de garantir une bonne conservation, en inhibant les activités
enzymatiques après la récolte, en empêchant la dégradation de certains
constituants ainsi que la prolifération bactérienne, le séchage apparaît comme
une étape essentielle. Les techniques de dessiccation sont variables :
• au soleil et à l'air libre (écorces et racines) ;
• à l'abri de la lumière (fleurs)
• à une température de séchage bien choisie pour éviter une altération de la
composition chimique.
Production des drogues
Les drogues végétales proviennent de plantes sauvages ou cultivées. La
qualité finale de la drogue dépend des conditions de culture, de récolte, de
séchage, de fragmentation et de stockage. Les drogues doivent être exemptes
d'éléments étrangers tels que terre, poussières, souillures, signes d'infection
fongique ou de contamination animale, traces de pourriture... Si un traitement
décontaminant s'avère indispensable, il faut prouver qu'il n'altère pas les
constituants de la plante et qu'il ne subsiste aucun composé nocif à l'issu du
traitement.
Provenance des drogues
En fonction de la provenance de la drogue, la teneur en principes actifs peut
varier de manière plus ou moins importante, entraînant une activité à priori
variable d'un lot à un autre. Il faut donc faire attention à l'origine
géographique et aux conditions écologiques (altitude, degré de fertilisation du
sol, caractère sauvage ou cultivé de la plante...).
Risques de falsification
Des risques volontaires ou involontaires de falsification ne sont pas à
exclure et peuvent entraîner des conséquences sérieuses pour l'utilisateur.
Les méthodes d'identification botanique
On distingue trois types d'examen pour la diagnose botanique :
L'examen organoleptique
Il permet de repérer les éléments d'identification immédiats comme la
morphologie, la couleur, la saveur mais aussi :
• le degré de pureté : moisissures, éléments étrangers ;
• les altérations : humidité, traces d'utilisation de solvants
• falsifications
Racines, rhizomes, écorces : l'examen s'oriente plus spécifiquement
sur :
• l'aspect général (cannelle de Ceylan)
• l'aspect de la tranche pour les racines épaisses (colombo)
• la cassure plus ou moins fibreuse (réglisse)
• l'aspect extérieur de l'écorce (lenticelles de la bourdaine)
Tiges : il faut s'attarder sur :
• la forme : cannelée (Apiacées) ou carrée (Lamiacées)
• la couleur (rouge pour la menthe poivrée)
• la présence ou l'absence de poils
• l'implantation des feuilles de type alterne ou opposé
• la présence ou l'absence de moelle (Poacées) ou de nœuds (Caryophyllacées)
Feuilles : l'examen porte sur :
• la couleur : brunâtre ou même noirâtre en cas de mauvais séchage
• la forme générale
• les nervures plus ou moins marquées
• le bord du limbe
• la présence ou l'absence de duvet
• la présence de pétioles
Inflorescences et fleurs : examen des bractées, sépales, pétales
Fruits et graines : la forme, la taille et la couleur constituent les
éléments déterminants.
L'étude microscopique
C'est un examen utile pour dissiper un doute ou confirmer une diagnose. Il
peut être pratiqué sur des coupes d'organes ou sur une drogue pulvérisée. Les
modalités pratiques de l'examen sont disponibles dans de nombreux ouvrages et ne
seront donc pas détaillées ici.
Les méthodes d'identification chimique
L'identification d'une drogue végétale repose généralement sur la mise en
évidence de certains constituants issus du métabolisme secondaire.
Les réactions d'identité
Ces réactions faciles à réaliser, rapides, permettent la mise en évidence de
certaines classes de substances chimiques (alcaloïdes, flavonoïdes, coumarines,
saponosides...) en faisant apparaître soit une coloration, soit une
précipitation, dont l'intensité permet en outre d'avoir une idée sur la
concentration en principes actifs. Elles sont adaptées pour des constituants
présents en quantité importante et servant de marqueur ou de traceur.
L'interprétation des résultats doit toutefois se faire avec une certaine
prudence.
Les analyses chromatographiques
Les pharmacopées exigent le recours à diverses techniques chromatographiques
afin de garantir l'identité et la qualité pharmaceutique d'une drogue. Ces
méthodes reposent sur un principe constant : les substances présentes en mélange
sont séparées à l'aide d'un support solide (plaque ou colonne) et d'un éluant
(solvants organiques, gaz). Il existe de nombreuses méthodes décrites dans
d'excellents ouvrages analytiques. Par souci de concision, on détaillera
uniquement la chromatographie sur couche mince, qui représente la méthode de
choix des laboratoires de contrôle.
La chromatographie sur couche mince (CCM)
La chromatographie sur couche mince est une technique de séparation, dans
laquelle une phase stationnaire constituée d'un matériau approprié est répandue
en une couche mince et uniforme sur un support (plaque de verre, de métal ou de
plastique). Les solutions à analyser sont appliquées sur la plaque avant le
développement. La séparation repose sur des mécanismes d'adsorption, de partage
ou d'échange d'ions ou sur une combinaison de ces mécanismes, et elle s'effectue
par migration (développement) de solutés à travers la couche mince (phase
stationnaire), dans un solvant ou un mélange de solvants approprié (phase
mobile). (Définition d'après la Pharmacopée européenne)
L'appareillage est constitué de plaques préfabriquées, d'une cuve à
chromatographie, de micropipettes, de microseringues ou de capillaires calibrés
jetables, d'un dispositif de détection de fluorescence et des réactifs de
visualisation aptes à révéler les taches séparées correspondant aux substances
présentes, soit par pulvérisation, soit par exposition aux vapeurs ou immersion.
Des protocoles verticaux ou horizontaux peuvent être utilisés. L'identification
repose sur l'estimation visuelle de la migration, après vérification du pouvoir
de séparation et recherche des substances apparentées.
Cette méthode, simple, peu onéreuse et nécessitant des prises d'essai peu
importantes, est adaptée pour un contrôle rapide des drogues végétales.
Les constituants sont séparés dans conditions précises faisant intervenir la
nature du support, la distance de migration, la nature de l'éluant et la
révélation est effectuée par des réactifs adéquats.
On peut utiliser diverses substances à examiner en parallèle. Selon les cas, il
peut s'agir :
• d'une substance unique, spécifique de la drogue (anéthole pour la badiane...)
;
• d'un mélange de substances, pour lesquelles la teneur ou la simple présence
est bien définie (alcaloïdes du quinquina rouge...) ;
• d'une substance étrangère à la drogue, mais présentant un profil
chromatographique équivalent à celui d'une substance de référence à l'état
pur, pour un coût moindre (phénazone migrant pratiquement au même niveau que l'amarogentioside
de la gentiane...) ;
• d'un extrait de référence, comme pour le séné.
Les limites de la technique sont liées à l'impossibilité de quantifier la teneur
des constituants présents.
La chromatographie en phase gazeuse (CPG)
La chromatographie en phase gazeuse (CPG) est une technique de séparation
chromatographique reposant sur la distribution différentielle des espèces entre
deux phases non miscibles, une phase stationnaire contenue dans une colonne et
un gaz vecteur, comme phase mobile, qui traverse cette phase stationnaire. Elle
est applicable aux substances, ou dérivés de substances, qui se volatilisent
dans les conditions de température utilisées.
La CPG est fondée sur les mécanismes d'adsorption, de distribution de masse ou
d'exclusion. (Définition d'après la Pharmacopée européenne)
La chromatographie liquide (CL)
La chromatographie liquide (CL) est une technique de séparation
chromatographique reposant sur la distribution différentielle des espèces entre
deux phases non miscibles, une phase stationnaire contenue dans une colonne et
une phase mobile qui traverse, par percolation, cette phase stationnaire. La CL
est principalement fondée sur les mécanismes d'adsorption, de distribution de
masse, d'échange d'ions, d'exclusion ou d'interaction stéréochimique.
L'appareillage se compose d'un système de pompage, d'un injecteur, d'une colonne
chromatographique (éventuellement thermostatée), d'un détecteur et d'un système
d'acquisition des données (ou d'un intégrateur ou enregistreur). La phase
mobile, délivrée à partir d'un ou plusieurs réservoirs, circule à travers la
colonne, généralement à débit constant, puis passe à travers le détecteur.
Les essais
La réalisation de certains essais permet de garantir la qualité intrinsèque
de la drogue.
Taux de cendres
La totalité des matières organiques de la drogue est éliminée par
carbonisation et la pesée du résidu, uniquement constitué de matières minérales,
permet d'évaluer le degré de propreté de la plante (une addition, volontaire ou
non, de terre ou de sable au moment de la récolte, ou un lavage insuffisant de
la matière première, augmentant le taux de cendres), ainsi que de déterminer les
agents de fertilisation utilisés durant la culture. Il est à noter que certaines
plantes, riches en minéraux (oxalate de calcium pour certaines Solanacées,
silice pour la prêle) présentent un taux de cendres naturellement élevé.
Teneur en eau et perte à la dessiccation
Selon la Pharmacopée européenne, la perte à la dessiccation est la perte de
masse exprimée en pourcentage m/m. Le mode opératoire est précisé dans chaque
monographie de plante. La dessiccation peut s'effectuer jusqu'à masse constante
ou pendant une durée déterminée, soit dans un dessiccateur en présence de
pentoxyde de diphosphore, soit sous vide avec indication d'un intervalle de
température, à l'étuve ou sous vide poussé. Dans le cas des drogues à huile
essentielle, un essai de teneur en eau est réalisé. Il est à noter qu'un
pourcentage d'eau trop élevé permet à un certain nombre de réactions
enzymatiques de se développer, entraînant des conséquences néfastes sur l'aspect
des drogues, leurs caractères organoleptiques, leurs propriétés thérapeutiques.
En outre, une humidité résiduelle favorise le développement de microorganismes
(bactéries, levures, moisissures).
Nature et taux des éléments étrangers
Les éléments étrangers sont séparés en deux catégories par la Pharmacopée
européenne :
• les parties étrangères : éléments provenant de la plante-mère, mais ne
constituant pas la drogue ;
• les matières étrangères : éléments étrangers à la plante-mère, d'origine
végétale ou minérale.
La recherche se fait par l'examen macroscopique de la drogue au cours duquel on
recherche la présence de matières étrangères (petits graviers, coquilles
d'escargots...) mais aussi de parties étrangères (fragments de tiges
accompagnant des feuilles mondées...). La pharmacopée tolère en général un taux
maximal de 2 % d'éléments étrangers.
Résidus de produits phytosanitaires et pesticides
Est considérée comme pesticide toute substance ou association de substances
destinée à repousser, détruire ou combattre les ravageurs et les espèces
indésirables de plantes et d'animaux, causant des dommages ou se montrant
autrement nuisibles durant la production, la transformation, le stockage ou la
mise sur le marché de substances médicinales d'origine végétale. Ce terme
comprend les substances destinée à être utilisées comme régulateurs de
croissance des plantes, comme défoliants, comme agents de dessiccation, ainsi
que les substances appliquées sur les cultures, soit avant, soit après la
récolte, pour protéger les produits contre la détérioration durant l'entreposage
ou le transport. (Définition d'après la Pharmacopée européenne)
De nos jours, la culture des plantes médicinales se substitue à la récolte
manuelle de plantes sauvages, entraînant une généralisation de l'utilisation de
produits phytosanitaires (pesticides, insecticides, herbicides, fongicides...).
Les traitements employés peuvent varier d'un pays producteur à un autre et, si
l'utilisation de produits phytosanitaires est réglementée dans la plupart des
pays européens et des territoires d'outre mer, cette législation est inexistante
dans de nombreux pays en voie de développement où l'utilisation de pesticides
désormais prohibés comme le DTT n'est pas exceptionnelle. Enfin, l'apparition
régulière sur le marché de nouveaux produits phytosanitaires complique encore le
travail de réglementation.
Les analyses, reposent sur des méthodes spécifiques de dosage par
chromatographie en phase gazeuse, la Pharmacopée européenne donnant des valeurs
limites de tolérance (en mg/kg) pour 34 pesticides. Les tolérances applicables
aux pesticides ne figurant pas dans cette monographie sont calculées à partir de
la dose journalière admissible par La FAO/OMS et sont fonction de la masse
corporelle et de la consommation journalière de la drogue, et ce sur un schéma
analogue à celui employé pour la législation des produits alimentaires.
Contamination microbiologique
Les drogues végétales sont généralement sujettes à la contamination par les
microorganismes présents dans le sol, le fumier, les poussières. Le degré de
contamination est variable d'une drogue à une autre et est généralement compris
entre 102 et 108
germes par gramme de plante. Cependant, la quantité de germes présents n'a en
réalité que peu d'importance face à l'impératif de ne présenter aucun germe
pathogène, notamment en ce qui concerne les entérobactéries.
Les opérations susceptibles de limiter la présence des germes dans les drogues
sont malheureusement également capable de dégrader les constituants présents :
• la pasteurisation ou l'autoclavage des drogues n'est pas utilisable.
• la chaleur sèche est envisageable dans de rares cas.
• les vapeurs d'oxyde d'éthylène, longtemps utilisées pour la réduction
simultanée du nombre de germes mais aussi d'insectes, sont interdites en Europe
depuis le 31 décembre 1990, en raison de la formation de produits résiduels
toxiques et mutagènes.
• les rayonnements ionisants sont utilisables à de très faibles doses
(inférieurs à 10 KGy) pour éviter la dénaturation des constituants, notamment
les polysaccharides. En outre, la déclaration de ce traitement est obligatoire.
La pharmacopée européenne propose des spécifications concernant la qualité
microbiologique des préparations pharmaceutiques. Les médicaments à base de
plantes présentent des normes distinctes, selon que l'eau bouillante est
utilisée ou non, la quantité de germes présents décroissant au cours de la
préparation d'une infusion. Les principaux germes recherchés sont les germes
aérobies, les moisissures, les levures, les entérobactéries et certaines autres
bactéries gram-négatives, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus
aureus, Escherichia coli, les salmonelles.
Contamination par les métaux lourds
Les métaux lourds incriminés sont le cadmium, le cuivre, le fer, le nickel,
le plomb, le zinc, l'arsenic et le mercure.
En Allemagne, le Ministère Fédéral de la Santé a édité un projet nommé
"Recommandations en matière de contaminants et de métaux lourds" destiné aux
plantes, parties de plantes, huiles végétales, matières grasses, cires et
produits qui en dérivent...". Des exceptions à ces normes sont prévues pour les
drogues dont les matières premières sont connues pour accumuler du cadmium en
grande quantité.
Les teneurs limites maximales prévues sont, hors exceptions, de 5 mg/kg pour
le plomb, de 0.2 mg/kg pour le Cadmium et de 0.1 mg/kg en ce qui concerne le
mercure.
Contamination par les aflatoxines
Il est d'usage d'utiliser les valeurs limites suivantes, issues de
l'industrie alimentaire :
• Aflatoxines B1 : max 2 mg/kg
• Somme totale des aflatoxines B1, B2, G1, G2 : max 4 mg/kg
Contamination par les substances radioactives
La norme officielle adoptée par la communauté européenne pour les produits
d'origine alimentaire, se situe à un maximum de 600 Bq/kg. Il n'existe à l'heure
actuelle aucune méthode pharmaceutique officielle.
Contamination par les solvants
Les médicaments à base de plantes sont préparés à partir d'un nombre limité
de solvants parmi lesquels on trouve l'alcool, le méthanol, plus rarement
l'acétone, l'acétate d'éthyle, le n-butanol, l'hexane et l'heptane. Les teneurs
en méthanol et en isopropanol doivent généralement rester inférieures à 0.05 %
(500 ppm).
On distingue trois catégories de solvants selon leurs risques potentiels :
• classe 1 : solvants ne devant pas être utilisés : benzène, tétrachlorure de
carbone
• classe 2 : solvants présentant des limites d'utilisation : chloroforme,
cyclohexane, éthylène glycol, hexane, méthanol, pyridine, toluène, xylène
• classe 3 : solvants à faible potentialité toxique : acétone, acide acétique,
butanol, éthanol, éther éthylique, méthyléthylcétone, 1-propanol et 2-propanol.
Les dosages
Les essais sont toujours complétés par des dosages attestant du degré
d'activité thérapeutique de la drogue et gage de sa qualité pharmaceutique.
Une obligation
L'existence de variations saisonnières, voire journalières pour certaines
espèces végétales, impose un dosage des constituants actifs et des traceurs. La
pharmacopée indique des minima requis pour chaque drogue ou des fourchettes, le
cas échéant.
La réalisation pratique
Les plantes peuvent schématiquement se répartir entre 3 groupes :
• des plantes à constituants chimiquement bien définis et dont l'activité
thérapeutique est totalement connue : dérivés anthraquinoniques, comme les
sennosides de Cassia senna et C. angustifolia...
Le dosage est réalisé directement sur l'extrait végétal ou après purification,
par CPG pour les substances volatiles, par CLHP pour les substances fixes, par
spectrophotométrie si les molécules absorbent dans l'UV.
• des plantes à groupes de substances actives comme les iridoïdes, les
saponosides, les dérivés flavonoïdiques, coumariniques...
Le dosage se fait par spectrophotométrie sur un mélange plus ou moins concentré
d'intermédiaires de biosynthèse aux activités pharmacologiques très voisines.
• des plantes à constituants ou groupes de constituants pour lesquels l'activité
thérapeutique n'est pas élucidée. Il faut alors choisir un ou des traceurs (ou
marqueurs) afin de les utiliser comme substance de référence ; le choix du
traceur est donc fondamental pour pouvoir servir de référence pour l'analyse de
différents lots.
Le contrôle de stabilité
La composition chimique des drogues peut se modifier au cours du temps, en
dépit des précautions prises pour le stockage.
Pour juger de la stabilité d'une drogue à huile essentielle, la teneur en
essence est le critère de choix ; en effet, les plantes aromatiques perdent
naturellement leur huile essentielle au fil du temps, par évaporation, et ce
d'autant plus rapidement qu'elles sont finement divisées.
Outre ces modifications d'ordre quantitatif, une altération de la qualité même
de la drogue est également à craindre. Il est à noter que la dégradation
partielle de constituants "primaires" est parfois souhaitable et recherchée afin
d'accroître l'efficacité ou la sécurité d'emploi de drogues végétales. Il en va
ainsi pour les écorces de bourdaine et de cascara qui doivent être conservées
pendant au moins un an avant leur utilisation afin de permettre l'oxydation des
anthrones purgatives en anthraquinones laxatives, d'action moins drastique.
Enfin, les préparations à base de drogue végétale ou les médicaments qui en sont
issus doivent garantir la stabilité de leurs constituants au fil du temps. Les
médicaments présentés sous forme de solution (teintures alcooliques, sirop...)
ont des durées de stabilité inférieures à celles des extraits secs ou des
poudres.
La conservation et le stockage
Les principaux facteurs à prendre en compte sont la lumière, la température,
le degré d'humidité, l'importance de la fragmentation et le type de récipient
utilisé pour le stockage.
La protection par rapport à la lumière est indispensable pour la majorité des
drogues puisque feuilles, fleurs, se décolorent rapidement à la lumière,
entraînant une dégradation de leur aspect, associée à une éventuelle
modification des constituants présents.
Une hausse de la température de 10 °C double la vitesse de dégradation.
Le taux d'humidité relative doit être maintenu inférieur à 60 %.
La fragmentation augmente la surface de contact avec l'air et accélère
donc la dégradation.
Le stockage doit privilégier un endroit sec bénéficiant d'une température et
d'une humidité plus ou moins constante.
A l'officine, les drogues sont conservées dans des récipients fermés
hermétiquement, éventuellement munis d'un moyen de dessiccation adapté (gel de
silice en général). Il faudra surveiller l'apparition de charançons et autres
insectes et se débarrasser rapidement des lots infestés. L'usage de boites en
carton est préférable à celui de récipients en matières plastiques qui absorbent
les substances volatiles comme les huiles essentielles.
La durée de conservation ne saurait excéder 2 à 3 ans.
|