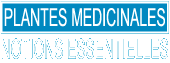Principes fondamentaux de phytothérapie
Quelques repères historiques
Les premières traces de l'utilisation des plantes médicinales sont présentes
dans des textes chinois datant de plus de 5000 ans avant J.C. Des inscriptions
cunéiformes sur des tablettes sumériennes de Mésopotamie font état de
l'utilisation du pavot, 2000 ans avant J.C.
Les Égyptiens possédaient déjà des
notions de pharmacopée et on peut voir la représentation de plus de 200 plantes
différentes sur les bas-reliefs du temple de Karnak (1450 avant J.C.).
La Grèce antique s'est illustrée avec les premiers thérapeutes, botanistes
et herboristes du monde occidental : Hippocrate (460-377 avant J.C.), père et
symbole de la médecine, Théophraste (382-287 avant J.C.) qui nomma 500 espèces
de plantes, Dioscoride (100 ans avant J.C.), auteur d'un recueil de cinq livres
consacrés à près de 600 plantes médicinales, Galien (130-201), considéré comme
le père de la pharmacie.
Toutes les grandes civilisations développèrent leurs propres traditions
phytothérapiques ; Chinois, Mayas, Aztèques, Incas connaissaient et utilisaient
des remèdes à base de plantes.
Au Moyen-Âge, l'Europe vit naître de nombreuses écoles de médecine, comme celle
de Salerne, en Italie, qui utilisait la sauge.
Parallèlement, pharmaciens et médecins arabes permirent d'importantes avancées
comme la découverte des techniques d'extraction des essences par distillation.
Le développement des explorations, débuté avec Christophe Colomb, fut à
l'origine de la découverte de nouvelles espèces comme le bois de gaïac, la coca,
le quinquina, le gingembre, la cardamome, le curcuma, la muscade, le safran, le
séné...
Paracelse (1493-1541), considéré comme le père de la chimie, développa sa
célèbre théorie des signatures, selon laquelle les propriétés d'une plante
seraient "signées" par sa morphologie ou même son habitat.
En 1692, paraissait la première "Pharmacopée Royale Galénique et Chymique",
recueil de préparations médicamenteuses. Le premier codex français fut édité en
1818 et les éditions se sont succédées jusqu'à la dernière édition de la
pharmacopée européenne.
Dès le XVIIe siècle, des botanistes
participèrent au développement d'une classification des végétaux, parmi lesquels
on ne peut oublier C. Linné (1707-1778), le père de la systématique, et le
naturaliste Buffon (1707-1788).
Au XIXe siècle, la découverte des
molécules uniques, qui confèrent leur activité aux drogues héroïques marqua une
nouvelle étape. En 1819, Meissner proposa le nom d'alcaloïde, en raison des
propriétés basiques de ces substances azotés ; dans le cas du pavot, la morphine
fut isolée en 1817, la codéine en 1832, la papavérine en 1842, même si les
structures chimiques détaillées ne furent élucidées que bien plus tard. C'est
également l'époque de l'isolement de l'inuline à partir de l'aunée (1804), de la
quinine, la strychnine et de la colchicine (1820), de l'acide salicylique de
l'écorce de saule (1838)...
Vers 1850, le physiologiste C. Bernard (1813-1878) créait les bases de la
pharmacologie expérimentale à partir d'études menées sur les curares des Indiens
de l'Amazonie et de Colombie.
Plus récemment, on assista à un essor de l'utilisation de drogues sous formes
d'extraits, comme l'aubépine, le ginkgo... D'autres continuent à apparaître
constamment, dans de nouveaux axes thérapeutiques (millepertuis, épilobe,
echinacea...).
Enfin, depuis 1950, des milliers de travaux de pharmaco-toxico-chimie sur les
produits naturels se sont succédés et furent parfois à l'origine d'avancées
concrètes pour les malades.
L'évolution du concept de "médicament"
Une espèce végétale est à même de synthétiser plusieurs milliers de
constituants chimiques différents, faisant partie de deux types de métabolisme
distincts :
• Un métabolisme primaire élabore des éléments indispensable à la vie de la
plante, comme certaines protéines, des lipides, des glucides...
• Un métabolisme secondaire, forgé au fil du temps et de l'évolution,
propre à chaque espèce végétale, est à l'origine d'une biodiversité moléculaire
exceptionnelle. Ce métabolisme secondaire est une source inépuisable de
découvertes pour les scientifiques, chaque nouvelle molécule isolée pouvant
potentiellement servir de base à la synthèse de nouveaux médicaments.
Au cours des siècles, le médicament a évolué en suivant la recherche
de la plus grande efficacité. Ainsi, au Moyen-Âge, la composition des remèdes,
ou thériaques, faisait intervenir un nombre faramineux d'espèces végétales,
animales, voire minérales. On recherchait alors la panacée, visant à guérir
tous les maux, en agissant sur tous les organes, sans distinction.
Plus récemment, les recherches se sont orientées vers une plus grande
simplification, préférant l'usage de solutions extractives, comme les
teintures, à celui, désormais obsolète, des potions moyenâgeuses. Le solvant
de choix était l'éthanol, à un degré alcoolique adapté à la solubilité des
composants à extraire. La teinture fut ensuite abandonnée pour l'extrait puis
on isola les constituants majoritaires de ces extraits par cristallisation.
Aujourd'hui, on réalise de plus en plus souvent des opérations d'hémisynthèse
sur les composés extraits afin de moduler l'activité, agir plus spécifiquement
sur une cible ou encore limiter les effets indésirables.
Définition de la pharmacognosie
Pharmacognosie vient du grec "gnosis" signifiant connaissance et "pharmakon"
qui se traduit par médicament ou remède. La pharmacognosie est donc une
discipline s'intéressant à l'étude de remèdes d'origine minérale, végétale ou
animale. De nos jours, l'utilisation de médicaments issus de produits animaux
est en diminution, en raison des risques sanitaires et les substances
indispensables à l'homme, comme l'insuline, sont désormais synthétisées par les
biotechnologies. La consommation de substances minérales (kaolin, talc,
hydroxydes d'alumine...) sous forme de médicaments reste stable mais
relativement limitée. En revanche, la part de médicaments issus de produits
végétaux est en constante hausse, renforcée par un effet de mode, peut-être plus
durable qu'on n'aurait pu le supposer initialement, pour l'utilisation de
molécules assurant une prévention de la santé, ou favorisant le développement
aussi bien physique qu'intellectuel. Les nombreux compléments alimentaires (on
parle aujourd'hui volontiers d'"alicaments") rencontrent dans cet optique un
franc succès. La frontière entre compléments alimentaires et médicaments à base
de plantes devient par ailleurs plus complexe à déterminer et le rôle de la
pharmacognosie est donc de fournir des réponses scientifiques à cette question.
On peut ainsi définir la pharmacognosie comme étant une discipline fondée sur la
connaissance scientifique fondamentale et appliquée des matières premières et
des substances naturelles de notre environnement qui ont été sélectionnées au
cours des siècles pour la thérapeutique ou qui ont fait leurs preuves cliniques
dans la médecine actuelle.
Elle s'intéresse particulièrement aux points suivants :
- Dénomination internationale des matières premières
- Biosynthèse des molécules
- Structures chimiques
- Contrôles de qualité
- Propriétés pharmacologiques et toxicologiques
- Applications en médecine humaine et médicaments qui en dérivent.
Cette science trouve ses origines dans les utilisations empiriques ancestrales
mais aussi dans la biodiversité actuelle de notre environnement. Elle évolue
actuellement vers la pharmacochimie des molécules, qui cherche à mettre en
exergue les interactions entre les molécules présentes dans une plante et les
récepteurs humains, ainsi que l'aspect des liaisons entre leurs structures
tridimensionnelles.
L'observation clinique est indissociable des médecines dites "traditionnelles".
Les résultats de ces observations, affinés par certaines données obtenues
expérimentalement, donnèrent naissance à diverses pharmacopées traditionnelles,
spécifiques à chaque région ou pays, selon les plantes disponibles dans
l'environnement et en fonction des traditions d'utilisations populaires.
On distingue deux types de plantes utilisées en thérapeutique :
• Des plantes dont les constituants actifs sont parfaitement définis
Il s'agit alors généralement de matières premières utilisées pour l'extraction
industrielle de substances naturelles pures, destinées le plus souvent à des
indications thérapeutiques essentielles.
Parmi ces molécules, on trouve :
- la morphine, extraite du pavot et de l'opium, à l'origine des analgésiques
centraux de synthèse
- la cocaïne, issue de la coca, qui a donné la série des anesthésiques locaux
- la coumarine du mélilot qui a permis la naissance des anticoagulants de
synthèse
- la quinine du quinquina, l'un des premiers antimalariques
- mais aussi l'éphédrine, la réserpine, la théophylline, l'atropine, l'émétine,
la digoxine, la digitaline, l'ergotamine...
Ces molécules sont en général dotées d'activités thérapeutiques élevées et ne
sont le plus souvent délivrées que sur prescription médicale.
• Des plantes médicinales de longue tradition d'utilisation pour des
indications mineures
Elles sont utilisées pour des pathologies de moindre gravité mais qui peuvent
rendre la vie difficile.
Elles interviennent en outre dans la composition de produits de bien être ou de
médications familiales et sont le plus souvent disponibles sans ordonnance ou
sur conseil du pharmacien d'officine. Ce sont ces plantes qui représentent ce
que l'on appelle communément la phytothérapie.
La phytothérapie proprement dite
Des éléments à prendre en compte
La plante, organisme vivant, marque son identité par des spécificités
morphologiques, à l'origine de la classification botanique, mais aussi
biochimiques, liées à des voies de biosynthèses inédites, représentant
l'intérêt de l'usage des plantes médicinales.
Le médicament à base de plantes est, quant à lui, un "complexe" de molécules,
issu d'une ou plusieurs espèces végétales et souvent proposé de nos jours sous
des formes galéniques innovantes, contribuant à rendre l'infusion originelle
plus ou moins désuète. Néanmoins, la biodisponibilité, le métabolisme peuvent
se trouver modifiés par rapport à ceux des remèdes traditionnels.
Le conseil en phytothérapie est donc un art difficile, en raison d'indications
potentiellement différentes d'une même plante suivant la forme retenue
(poudre, teinture, huile essentielle...), mais aussi à cause de phénomènes de
variabilité des effets, propres au patient. La phytothérapie nécessite ainsi
une maîtrise rigoureuse de la composition, de la fabrication et enfin de la
dispensation.
Un créneau d'indication délimité
Les drogues, initialement utilisées sous forme de tisane, ont été
introduites en thérapeutique à une époque ou des disciplines comme la
pharmacologie, la pharmacie clinique, la pharmacocinétique n'existaient pas
encore. A cette période, aucune preuve de qualité, d'efficacité ou d'innocuité
n'était exigée.
Pour autant, il serait bien inutile de réaliser les études cliniques et
toxicologiques, indispensables à la mise sur le marché d'un nouveau
médicament, pour des capitules de camomille. Mais doit on pour autant
dédaigner ces remèdes d'antan, sous prétexte que leurs constituants actifs ne
sont pas toujours démasqués et leurs modes d'action élucidés, alors que le
recul d'utilisation nous garantit efficacité et sécurité ? Il est vrai que si
certains praticiens ou pharmaciens peuvent avoir un à priori négatif vis à vis
de la phytothérapie, inversement, certains patients ne jurent que par les
plantes, répétant à l'envie que "cela ne peut pas faire de mal". Il est utile
de leur rappeler que la digitale peut être un cardiotoxique mortel à fortes
doses, que la strychnine et de nombreux autres alcaloïdes sont bel et bien
des produits naturels toxiques, que l'utilisation du millepertuis peut générer
un certain nombre d'interactions médicamenteuses...
Les médicaments de phytothérapie ou à base de plante peuvent schématiquement
s'inscrire dans deux domaines d'indications traditionnelles :
• Des indications de première intention, propres au conseil
pharmaceutique
Elles concernent notamment les pathologies saisonnières depuis les troubles
psychosomatiques légers jusqu'aux symptômes hépatobiliaires, en passant par
les troubles digestifs ou dermatologiques...
• Des indications liés à une thérapeutique de complémentarité
Elles viennent compléter ou renforcer l'efficacité d'un traitement
allopathique classique pour des pathologies aiguës d'importance modérée
(infection grippale, pathologies ORL...).
Définition de la phytothérapie
La phytothérapie est une discipline allopathique destinée à prévenir et à
traiter certains troubles fonctionnels et/ou certains états pathologiques au
moyen de plantes, de parties de plantes ou de préparations à base de plantes.
|