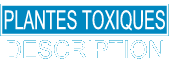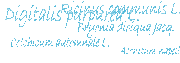|
|

|
If commun

|

|
Nom latin :Taxus baccata L.
Noms communs : If à baie, ifreteau Famille : Taxacées
Habitat : Bois, broussailles, alignements, sur sol
calcaire, jusqu'à 1800 m d'altitude
Floraison : Février - avril
Fréquence : Montagnes, et massivement planté |
|
|
Type végétal : Arbuste ou arbre
dioïque, à port largement étalé, souvent avec plusieurs tiges partant dès
la base, à écorce écailleuse, brun rougeâtre, s'exfoliant
Taille : Jusqu'à 15 m
Feuilles : Feuilles persistantes, en aiguilles plates,
molles, vert foncé à la face supérieure, plus claires à la face
inférieure, disposées dans un plan horizontal de part et d'autre des
rameaux
Fleurs : Pieds mâles portant de très nombreux petits cônes
globuleux, 5 mm, jaune ocre ; pieds femelles présentant des ovules nus
ressemblant à de petits bourgeons verdâtres
Fruits : Graines ovales, 8 mm, noires, entourées par une
arille charnue, 10-12 mm, ouverte au sommet, rouge, à chair rougeâtre
collante, l'ensemble faisant penser à un fruit charnu de type baie, d'où
l'appellation impropre de "baie d'if"
Toxicité :
 Plante très toxique Plante très toxique
Nature du toxique : Taxoïdes : alcaloïdes diterpéniques
tricycliques (taxine, taxol, céphalomannine...) ; traces d'éphédrine
Organes incriminés : Plante entière (à l'exception de
l'arille) mais ce sont principalement les feuilles, généralement à
l'origine d'intoxications volontaires, souvent fatales et les fruits, dont
l'aspect appétissant attire les jeunes enfants, qui représentent le risque
d'intoxication le plus élevé
Symptômes :
• Première phase :
- troubles digestifs : vomissements et diarrhées cholériformes
- troubles nerveux : tremblements, troubles visuels, mydriase, vertiges
- troubles cutanés : taches ecchymotiques
• Deuxième phase :
- troubles nerveux : excitation, puis dépression
- troubles respiratoires : dyspnée, parfois apnée
- troubles cardiovasculaires : hypotension, bradycardie, arythmie
• Troisième phase : coma avec signes convulsifs et collapsus
foudroyant (en 30 minutes après le début des manifestations)
Remarques :
• Le nom de genre Taxus viendrait du latin taxicum :
poison à l'origine de toxique ou du grec toxos : arc
• Le nom d'espèce baccata viendrait du fait que le pied
femelle porte un fruit d'aspect bacciforme
• L'if a longtemps été un symbole de mort : utilisé comme poison de
flèches pendant la préhistoire, arbre des cimetières, assurant le lien
entre les vivants et les morts, fabrication d'arcs meurtriers au cours de
nombreuses guerres...
• Aujourd'hui, l'if devient un symbole de vie : on extrait en effet
le taxol et le taxotère, anticancéreux remarquables de l'écorce ou des
feuilles de diverses espèces d'if.
|
|
|
|
Références bibliographiques
BISMUTH C., 2000. Toxicologie clinique. Éd. Médecine-Sciences - Flammarion.
BLAMEY M., GREY-WILSON C., 1991. La flore d'Europe occidentale. Éd. Arthaud.
BOUDOU-SEBASTIAN C., 2003. Baies et plantes toxiques. Le
moniteur des pharmacies et des laboratoires, cahier II du n°2490.
BOURBIGOT P., 1984. Contribution à l'étude des intoxications par les plantes à
baies ou à fruits bacciformes rouges. Thèse Pharmacie, Lyon I.
BROSSE J., 1995. Les fruits. Bibliothèque de l'image.
BRUNETON J., 2001. Plantes toxiques. Végétaux dangereux pour l'Homme et les
animaux. Éd. Tec et Doc et EMI.
CAJAT M. C., 1992. Plantes ornementales toxiques et intoxications dans la région
de Clermont-Ferrand : cas recensés par le CAP de 1988 à 1990 ; risques pour les
jeunes enfants : enquête réalisée sur les aires de jeu des écoles maternelles.
Thèse Pharmacie, Clermont I.
COUPLAN F., STYNER E., 1994. Guide des plantes comestibles et toxiques. Éd.
Delachaux et Niestlé.
DÄHNCKE R. M., DÄHNCKE
S., 1981. Les baies. Comment déterminer correctement les baies comestibles et
les baies toxiques. Miniguide Nathan.
DEBELMAS A. M., DELAVEAU P., 1983. Guide des plantes dangereuses. Éd. Maloine.
DELAVEAU P., 1974. Plantes agressives et poisons végétaux. Éd. Horizons de
France.
DESCOTES J., TESTUD F., FRANTZ P., 1992. Les urgences en toxicologie. Baies
toxiques (505-511). Autres plantes toxiques (513-523). Éd. Maloine.
ENGEL F., GUILLEMAIN J., 2003. Plantes irritatives et allergisantes
d'appartements et de jardins. Éd. Institut Klorane.
FOURASTE I., 2002. Fruits charnus sauvages et des jardins. Éd. Institut Klorane.
FOURASTE I., 2001. Plantes toxiques sauvages et horticoles. Éd. Institut Klorane.
FROHNE D., PFÄNDER J., 2002. A colour atlas of
poisonous plants. Manson Publishing, Londres.
JEAN-BLAIN C., GRISVARD M., 1973. Plantes vénéneuses. Toxicologie. La Maison
Rustique, Paris.
LAUX H. E. (et GUEDES M.), 1985. Baies et fruits dans nos bois et jardins. Éd.
Bordas.
MEYER F., 1989. Toxicité des baies et des fruits bacciformes. Quinze ans
d'expérience du centre antipoisons de Lyon. Thèse Médecine, Lyon I.
MONDOLOT-COSSON L., 1998. Les plantes toxiques. Le moniteur des pharmacies et
des laboratoires, cahier pratique du n°2259.
Phytoma - La défense des végétaux n°572., 1999. Toxicité des baies en espaces
verts.
Phytoma - La défense des végétaux n°517., 1999. Principales plantes ornementales
à baies toxiques.
REYNAUD J., 2002. La flore du pharmacien. Éd. Tec et Doc et EMI.
SPOERKE D. G. Jr., SMOLINSKE S. C., 1990. Toxicity of houseplants. CRC Presse,
Boston.
THIEVON P. 1992. Développement et première validation d'un système informatique
d'identification des baies. Thèse médecine, Lyon I.
TOUATI A., 1985. Plantes toxiques ornementales. Thèse Pharmacie, Rennes.
TROTIN F., 1975. Plantes toxiques. Diagnose et effets. Un problème de
l'officine. Bulletin de la Société de Pharmacie de Lille n°31 (79-95).
VERMARE D., 1986. Le pouvoir nocif des plantes d'ornement. Thèse Médecine, Lyon
I
|
|
|
|