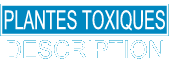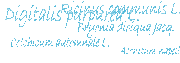|
|

|
Ricin

|

|
Nom latin : Ricinus communis L.
Noms communs : Palme du Christ Famille : Euphorbiacées
Habitat : Parcs et jardins, plates-bandes urbaines
Fréquence : Assez commun |
|
|
Type végétal : Herbacée annuelle
à tige dressée robuste, creuse, rougeâtre
Taille : Jusqu'à 2 m en Europe
Feuilles : Feuilles palmatilobée, à 5-12 lobes dentés en
scie, à pétiole et à limbe vert à pourpre selon les variétés
Fleurs : Fleurs unisexuées regroupées en grappes de cymes ;
fleurs femelles à ovaire tricarpellé et à longs styles rougeâtres,
occupant la moitié supérieure ; fleurs mâles à nombreuses étamines
ramifiées, aux anthères jaunâtres
Fruits : Capsules tricoques généralement hérissées de
pointes (mais parfois inermes), vertes à pourprées, déhiscentes par 3
fentes ; graine, 8-12 mm, à tégument lisse brillant, le plus souvent
marbré de brun ou de noir, présentant une face plane et une face bombée,
prolongée à l'extrémité supérieure par une proéminence charnue, la
caroncule, dont part une ligne saillante, bien visible sur la face
ventrale
Toxicité :
 Plante potentiellement très
toxique Plante potentiellement très
toxique
Nature du toxique : Les graines de ricin renferment de la
ricine, l'une des toxines végétales, d'origine protéique, les plus nocives
; le ricin contient également un allergène : le ricinallergène, qui fut la
cause d'allergies graves dans les industries d'extraction de l'huile mais
également à proximité des huileries de ricin ; l'huile enfin est riche en
acide ricinoléique
Organes incriminés : Graines et huile
Symptômes :
• Toxicité des graines :
- troubles digestifs : nausées, vomissements intenses et prolongés,
diarrhées éventuellement sanglantes, douleurs abdominales
- hyperthermie, tachycardie et contraction tétaniques avec spasmes de la
gorge
- sueur abondante et congestion des organes génitaux
• Toxicité de l'huile :
- purgation drastique par altération de la membrane intestinale avec perte
en eau et en électrolytes
Remarques :
• La ricine serait le toxique utilisé dans l'affaire des
"parapluies bulgares" qui défrayât la chronique à la fin des années
soixante-dix : le poison, dissimulé dans une microbille percée de 2 trous
était injecté à la malheureuse victime (opposants politiques réfugiés à
l'étranger).
• Selon les auteurs, 3 à 5 graines provoqueraient la mort d'un
enfant, 10 à 12 celle d'un adulte. La réalité est plus nuancée, avec une
notamment une mortalité bien loin d'être aussi importante, qui s'explique
peut-être par le fait que la graine est rarement mastiquée.
|
|
|
|
Références bibliographiques
BISMUTH C., 2000. Toxicologie clinique. Éd. Médecine-Sciences - Flammarion.
BLAMEY M., GREY-WILSON C., 1991. La flore d'Europe occidentale. Éd. Arthaud.
BOUDOU-SEBASTIAN C., 2003. Baies et plantes toxiques. Le
moniteur des pharmacies et des laboratoires, cahier II du n°2490.
BOURBIGOT P., 1984. Contribution à l'étude des intoxications par les plantes à
baies ou à fruits bacciformes rouges. Thèse Pharmacie, Lyon I.
BROSSE J., 1995. Les fruits. Bibliothèque de l'image.
BRUNETON J., 2001. Plantes toxiques. Végétaux dangereux pour l'Homme et les
animaux. Éd. Tec et Doc et EMI.
CAJAT M. C., 1992. Plantes ornementales toxiques et intoxications dans la région
de Clermont-Ferrand : cas recensés par le CAP de 1988 à 1990 ; risques pour les
jeunes enfants : enquête réalisée sur les aires de jeu des écoles maternelles.
Thèse Pharmacie, Clermont I.
COUPLAN F., STYNER E., 1994. Guide des plantes comestibles et toxiques. Éd.
Delachaux et Niestlé.
DÄHNCKE R. M., DÄHNCKE
S., 1981. Les baies. Comment déterminer correctement les baies comestibles et
les baies toxiques. Miniguide Nathan.
DEBELMAS A. M., DELAVEAU P., 1983. Guide des plantes dangereuses. Éd. Maloine.
DELAVEAU P., 1974. Plantes agressives et poisons végétaux. Éd. Horizons de
France.
DESCOTES J., TESTUD F., FRANTZ P., 1992. Les urgences en toxicologie. Baies
toxiques (505-511). Autres plantes toxiques (513-523). Éd. Maloine.
ENGEL F., GUILLEMAIN J., 2003. Plantes irritatives et allergisantes
d'appartements et de jardins. Éd. Institut Klorane.
FOURASTE I., 2002. Fruits charnus sauvages et des jardins. Éd. Institut Klorane.
FOURASTE I., 2001. Plantes toxiques sauvages et horticoles. Éd. Institut Klorane.
FROHNE D., PFÄNDER J., 2002. A colour atlas of
poisonous plants. Manson Publishing, Londres.
JEAN-BLAIN C., GRISVARD M., 1973. Plantes vénéneuses. Toxicologie. La Maison
Rustique, Paris.
LAUX H. E. (et GUEDES M.), 1985. Baies et fruits dans nos bois et jardins. Éd.
Bordas.
MEYER F., 1989. Toxicité des baies et des fruits bacciformes. Quinze ans
d'expérience du centre antipoisons de Lyon. Thèse Médecine, Lyon I.
MONDOLOT-COSSON L., 1998. Les plantes toxiques. Le moniteur des pharmacies et
des laboratoires, cahier pratique du n°2259.
Phytoma - La défense des végétaux n°572., 1999. Toxicité des baies en espaces
verts.
Phytoma - La défense des végétaux n°517., 1999. Principales plantes ornementales
à baies toxiques.
REYNAUD J., 2002. La flore du pharmacien. Éd. Tec et Doc et EMI.
SPOERKE D. G. Jr., SMOLINSKE S. C., 1990. Toxicity of houseplants. CRC Presse,
Boston.
THIEVON P. 1992. Développement et première validation d'un système informatique
d'identification des baies. Thèse médecine, Lyon I.
TOUATI A., 1985. Plantes toxiques ornementales. Thèse Pharmacie, Rennes.
TROTIN F., 1975. Plantes toxiques. Diagnose et effets. Un problème de
l'officine. Bulletin de la Société de Pharmacie de Lille n°31 (79-95).
VERMARE D., 1986. Le pouvoir nocif des plantes d'ornement. Thèse Médecine, Lyon
I
|
|
|
|