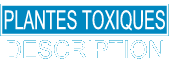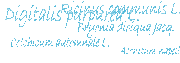|
|

|
Jusquiame noire

|

|
Nom latin : Hyoscyamus niger L.
Noms communs : Potelée Famille : Solanacées Habitat : Terrains
nus ou labourés, surtout près de la mer, près de bâtiments agricoles, sur
sol légers, riche en éléments nutritifs, jusqu'à 1700 m d'altitude
Floraison : Mai - septembre
Fréquence : Assez rare, absent au Sud-Est |
|
|
Type végétal : Herbacée annuelle
ou bisannuelle fétide, érigée, ramifiée ou non, à poils collants
Taille : Soit 30-50 cm (herbe annuelle), soit 40-80 cm
(herbe bisannuelle ramifiée)
Feuilles : Feuilles ovales à oblongues, en général
grossièrement dentées ou lobées, molles, très velues ; feuilles basales en
rosette lâche, feuilles supérieures alternes, sessiles, engainant la tige
Fleurs : Fleurs en trompette irrégulière, 2-3 cm, jaune pâle à
crème, rayée de nervures pourpres, avec une lèvre inférieure bien
définie, sur des épis ramifiés unilatéraux ; calice tubuleux, évasé à
l'extrémité en 5 petits lobes
Fruits : Pyxides renflées à la base, dentelées au sommet,
s'ouvrant par un clapet, et contenant de très nombreuses petites graines
chagrinées
Toxicité :
 Plante très toxique Plante très toxique
Nature du toxique : Principalement 3 alcaloïdes, esters de
l'acide troponique, du tropanol ou du scopanol :
• hyoscyamine (en fait la L-hyoscyamine, car lévogyre), qui prédomine dans
le végétal frais
• atropine (racémique de l'hyoscyamine et sans pouvoir rotatoire), qui
prédomine dans le végétal sec et le fruit mûr
• scopolamine également lévogyre.
La plante contient entre 0,05 à 0,15 % d'alcaloïdes, la scopolamine en
représentant de 25 à 40 %.
Organes incriminés : Tous les organes de la plante renferment
des alcaloïdes tropaniques, mais ce sont les graines qui présentent les
teneurs les plus élevées en alcaloïdes (0,3 %).
Symptômes : Ils sont liés aux propriétés antagonistes de
l'acétylcholine, se traduisant par un syndrome anticholinergique.
• Troubles digestifs immédiats avec nausées, vomissements destinés à
éliminer l'agent toxique
• Troubles neurovégétatifs :
- bouche sèche, constipation
- mydriase, troubles de l'accommodation, élévation de la pression
intra-oculaire, diminution de la sécrétion lacrymale
- tachycardie
- risque de rétention urinaire et de glaucome aigu en cas de glaucome à
angle fermé
• En cas d'intoxication aiguë : confusion mentale, hallucinations,
hyperthermie, coma et dépression respiratoire
Remarques :
• Les intoxications sont moins fréquentes qu'avec la belladone (fruit
sec moins appétissant, odeur fétide n'incitant guère à la consommation)
• La toxicité de la jusquiame est connue et redoutée depuis l'antiquité
(Égyptiens)
• Les Gaulois l'utilisaient pour empoisonner les pointes de leurs flèches.
• Elle entrait fréquemment dans la composition des boissons et baumes des
sorcières du Moyen Âge, à qui elle conférait
une sensation de légèreté, de lévitation, ce qui pourrait constituer une
explication au mythe populaire du déplacement aérien des sorcières.
• Au XVe siècle, on l'utilisait
comme anesthésique lors d'opérations chirurgicales.
• Il existe d'autres espèces de Hyoscyamus d'origine exotique
telles que H. albus, H. aureus, H. muticus, H.
faleslez, cette dernière ayant permis aux Touaregs d'empoisonner les
membres de la mission Flatters venus en Afrique du Nord étudier le trajet
du transsaharien. Certaines de ces espèces ont été introduites comme
ornementales et se sont naturalisées dans le Midi de la France, notamment H. albus, la jusquiame blanche (feuilles toutes pétiolées, fleurs,
à corolle nettement irrégulière, blanc jaunâtre, à gorge verdâtre non
veinée).
Toutes ces espèces présentent un risque toxique au moins aussi élevé que
celui représenté par H. niger.
|
|
|
|
Références bibliographiques
BISMUTH C., 2000. Toxicologie clinique. Éd. Médecine-Sciences - Flammarion.
BLAMEY M., GREY-WILSON C., 1991. La flore d'Europe occidentale. Éd. Arthaud.
BOUDOU-SEBASTIAN C., 2003. Baies et plantes toxiques. Le
moniteur des pharmacies et des laboratoires, cahier II du n°2490.
BOURBIGOT P., 1984. Contribution à l'étude des intoxications par les plantes à
baies ou à fruits bacciformes rouges. Thèse Pharmacie, Lyon I.
BROSSE J., 1995. Les fruits. Bibliothèque de l'image.
BRUNETON J., 2001. Plantes toxiques. Végétaux dangereux pour l'Homme et les
animaux. Éd. Tec et Doc et EMI.
CAJAT M. C., 1992. Plantes ornementales toxiques et intoxications dans la région
de Clermont-Ferrand : cas recensés par le CAP de 1988 à 1990 ; risques pour les
jeunes enfants : enquête réalisée sur les aires de jeu des écoles maternelles.
Thèse Pharmacie, Clermont I.
COUPLAN F., STYNER E., 1994. Guide des plantes comestibles et toxiques. Éd.
Delachaux et Niestlé.
DÄHNCKE R. M., DÄHNCKE
S., 1981. Les baies. Comment déterminer correctement les baies comestibles et
les baies toxiques. Miniguide Nathan.
DEBELMAS A. M., DELAVEAU P., 1983. Guide des plantes dangereuses. Éd. Maloine.
DELAVEAU P., 1974. Plantes agressives et poisons végétaux. Éd. Horizons de
France.
DESCOTES J., TESTUD F., FRANTZ P., 1992. Les urgences en toxicologie. Baies
toxiques (505-511). Autres plantes toxiques (513-523). Éd. Maloine.
ENGEL F., GUILLEMAIN J., 2003. Plantes irritatives et allergisantes
d'appartements et de jardins. Éd. Institut Klorane.
FOURASTE I., 2002. Fruits charnus sauvages et des jardins. Éd. Institut Klorane.
FOURASTE I., 2001. Plantes toxiques sauvages et horticoles. Éd. Institut Klorane.
FROHNE D., PFÄNDER J., 2002. A colour atlas of
poisonous plants. Manson Publishing, Londres.
JEAN-BLAIN C., GRISVARD M., 1973. Plantes vénéneuses. Toxicologie. La Maison
Rustique, Paris.
LAUX H. E. (et GUEDES M.), 1985. Baies et fruits dans nos bois et jardins. Éd.
Bordas.
MEYER F., 1989. Toxicité des baies et des fruits bacciformes. Quinze ans
d'expérience du centre antipoisons de Lyon. Thèse Médecine, Lyon I.
MONDOLOT-COSSON L., 1998. Les plantes toxiques. Le moniteur des pharmacies et
des laboratoires, cahier pratique du n°2259.
Phytoma - La défense des végétaux n°572., 1999. Toxicité des baies en espaces
verts.
Phytoma - La défense des végétaux n°517., 1999. Principales plantes ornementales
à baies toxiques.
REYNAUD J., 2002. La flore du pharmacien. Éd. Tec et Doc et EMI.
SPOERKE D. G. Jr., SMOLINSKE S. C., 1990. Toxicity of houseplants. CRC Presse,
Boston.
THIEVON P. 1992. Développement et première validation d'un système informatique
d'identification des baies. Thèse médecine, Lyon I.
TOUATI A., 1985. Plantes toxiques ornementales. Thèse Pharmacie, Rennes.
TROTIN F., 1975. Plantes toxiques. Diagnose et effets. Un problème de
l'officine. Bulletin de la Société de Pharmacie de Lille n°31 (79-95).
VERMARE D., 1986. Le pouvoir nocif des plantes d'ornement. Thèse Médecine, Lyon
I
|
|
|
|