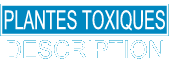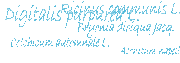|
|

|
Colchique

|

|
Nom latin : Colchicum autumnale L.
Noms communs : Veilleuse, faux safran, tue-chien, dame nue Famille : Liliacées
Habitat : Prairies humides, lisière des bois, sur sol
neutre ou calcaire, jusqu'à 2000 m d'altitude
Floraison : Août - septembre
Fréquence : Commun, sauf Pyrénées et Méditerranée ;
naturalisé au Danemark et en Suède |
|
|
Type végétal : Herbacée vivace
par un bulbe ovoïde, subglobuleux, à tunique coriace ou membraneuse,
fleurissant en automne avant l'apparition des feuilles
Taille : De 10 à 40 cm
Feuilles : Feuilles parrallélinerves, oblongues et
linéaires, acuminées, 20-40 cm, vert brillant, apparaissant au printemps
en même temps que le fruit
Fleurs : Fleurs régulières rosâtres ou lilas pourpré, rarement
blanches, 10-15 cm, ressemblant à celles du crocus, apparaissant par 2-5
en automne ; périanthe constitué de 6 pièces pétaloïdes ou tépales soudées
dans leur partie inférieure et formant un tube blanchâtre se prolongeant
jusqu'au bulbe ; étamines insérées sur le tube, portant des anthères
jaunes ; styles incurvés prolongeant les 3 carpelles soudés
Fruits : Capsules triloculaires vertes, se formant au
milieu des feuilles, d'abord sous la surface du sol, puis sortant lors du
développement des feuilles ; graines noires à pointe blanche, 2 mm
Toxicité :
 Plante très toxique,
représentant un risque réel pour le bétail, par contamination des foins Plante très toxique,
représentant un risque réel pour le bétail, par contamination des foins
Nature du toxique : Alcaloïdes tropoloniques dont la
colchicine
Organes incriminés : Plante entière mais ce sont les
graines qui renferment le plus d'alcaloïdes (0,3-1,2 % d'alcaloïdes totaux
et 0,3-0,8 % de colchicine) puis le bulbe (0,2-0,6 % d'alcaloïdes totaux)
et enfin les fleurs qui en renfermeraient 0,1 % (valeur non confirmée et
sujette à caution)
Symptômes :
• Irritation des voies digestives, soif intense, hypersalivation,
diarrhées profuses, vomissements, douleurs abdominales intenses,
météorisme, constriction laryngo-pharyngée
• Troubles cardiovasculaires avec hypotension
• Troubles nerveux tels que paralysie et paresthésie
• Troubles respiratoires avec cyanose et mort par asphyxie, survenant
entre 1 et 10 jours après l'intoxication
• En cas d'intoxication médicamenteuse par la colchicine, on a pu
observer une aplasie médullaire, avec septicémie à entérobactéries
(leucopénie) et risque hémorragique (thrombocytopénie), ainsi qu'une
alopécie complète, réversible et une polynévrite
Remarques :
• La plante tire son nom de celui de la Colchide, province située
à l'extrémité orientale de la mer Noire et colonisée très précocement par
les Grecs de Milet. Cette région est la patrie de l'empoisonneuse Médée
(magicienne redoutable de la mythologie grecque).
• La colchicine, très toxique, est néanmoins utilisée dans le
traitement de la goutte à une posologie très précise (1 à 3 mg par jour).
• A noter l'existence de variétés horticoles de Colchicum
ainsi que de genres voisins : Merendera, Gloriosa et
Bulbocodium à la toxicité similaire.
• On veillera à ne pas confondre cette plante avec le crocus aux
fleurs printanières toujours accompagnées de feuilles linéaires.
|
|
|
|
Références bibliographiques
BISMUTH C., 2000. Toxicologie clinique. Éd. Médecine-Sciences - Flammarion.
BLAMEY M., GREY-WILSON C., 1991. La flore d'Europe occidentale. Éd. Arthaud.
BOUDOU-SEBASTIAN C., 2003. Baies et plantes toxiques. Le
moniteur des pharmacies et des laboratoires, cahier II du n°2490.
BOURBIGOT P., 1984. Contribution à l'étude des intoxications par les plantes à
baies ou à fruits bacciformes rouges. Thèse Pharmacie, Lyon I.
BROSSE J., 1995. Les fruits. Bibliothèque de l'image.
BRUNETON J., 2001. Plantes toxiques. Végétaux dangereux pour l'Homme et les
animaux. Éd. Tec et Doc et EMI.
CAJAT M. C., 1992. Plantes ornementales toxiques et intoxications dans la région
de Clermont-Ferrand : cas recensés par le CAP de 1988 à 1990 ; risques pour les
jeunes enfants : enquête réalisée sur les aires de jeu des écoles maternelles.
Thèse Pharmacie, Clermont I.
COUPLAN F., STYNER E., 1994. Guide des plantes comestibles et toxiques. Éd.
Delachaux et Niestlé.
DÄHNCKE R. M., DÄHNCKE
S., 1981. Les baies. Comment déterminer correctement les baies comestibles et
les baies toxiques. Miniguide Nathan.
DEBELMAS A. M., DELAVEAU P., 1983. Guide des plantes dangereuses. Éd. Maloine.
DELAVEAU P., 1974. Plantes agressives et poisons végétaux. Éd. Horizons de
France.
DESCOTES J., TESTUD F., FRANTZ P., 1992. Les urgences en toxicologie. Baies
toxiques (505-511). Autres plantes toxiques (513-523). Éd. Maloine.
ENGEL F., GUILLEMAIN J., 2003. Plantes irritatives et allergisantes
d'appartements et de jardins. Éd. Institut Klorane.
FOURASTE I., 2002. Fruits charnus sauvages et des jardins. Éd. Institut Klorane.
FOURASTE I., 2001. Plantes toxiques sauvages et horticoles. Éd. Institut Klorane.
FROHNE D., PFÄNDER J., 2002. A colour atlas of
poisonous plants. Manson Publishing, Londres.
JEAN-BLAIN C., GRISVARD M., 1973. Plantes vénéneuses. Toxicologie. La Maison
Rustique, Paris.
LAUX H. E. (et GUEDES M.), 1985. Baies et fruits dans nos bois et jardins. Éd.
Bordas.
MEYER F., 1989. Toxicité des baies et des fruits bacciformes. Quinze ans
d'expérience du centre antipoisons de Lyon. Thèse Médecine, Lyon I.
MONDOLOT-COSSON L., 1998. Les plantes toxiques. Le moniteur des pharmacies et
des laboratoires, cahier pratique du n°2259.
Phytoma - La défense des végétaux n°572., 1999. Toxicité des baies en espaces
verts.
Phytoma - La défense des végétaux n°517., 1999. Principales plantes ornementales
à baies toxiques.
REYNAUD J., 2002. La flore du pharmacien. Éd. Tec et Doc et EMI.
SPOERKE D. G. Jr., SMOLINSKE S. C., 1990. Toxicity of houseplants. CRC Presse,
Boston.
THIEVON P. 1992. Développement et première validation d'un système informatique
d'identification des baies. Thèse médecine, Lyon I.
TOUATI A., 1985. Plantes toxiques ornementales. Thèse Pharmacie, Rennes.
TROTIN F., 1975. Plantes toxiques. Diagnose et effets. Un problème de
l'officine. Bulletin de la Société de Pharmacie de Lille n°31 (79-95).
VERMARE D., 1986. Le pouvoir nocif des plantes d'ornement. Thèse Médecine, Lyon
I
|
|
|
|