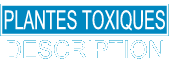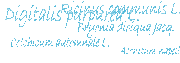|
|

|
Belladone

|

|
Nom latin : Atropa belladona L.
Noms communs : Belle dame, bouton noir, morelle marine,
herbe empoisonnée, guigne de la côte Famille : Solanacées
Habitat : Lieux humides ou ombragés, clairières, bords des
chemins, broussailles, sur sol calcaire, jusqu'à 1700 m d'altitude
Floraison : Août - octobre
Fréquence : Grande-Bretagne, Belgique, Pays-Bas, France,
Allemagne ; naturalisée en Irlande, Danemark et au sud de la Suède |
|
|
Type végétal : Herbacée vivace
vigoureuse, glabre, très ramifiée, à souche rhizomateuse
Taille : Jusqu'à 1,5 m
Feuilles : Feuilles entières, courtement pétiolées, ovales
acuminées, alternes à la partie inférieure de la tige, rapprochées par 2
et de taille inégale à la partie supérieure, d'odeur un peu fétide
Fleurs : Fleurs régulières, 25-30 mm, généralement solitaires ou
par 2, à l'aisselle des feuilles supérieures, à corolle campanulée violet
brunâtre ou verdâtre
Fruits : Baies globuleuses, 15 mm env., vertes puis
violet-noir à maturité, luisantes, à calice vert persistant, de forme
étoilée ; pulpe juteuse, violacée ; graines réniformes nombreuses, brun
noir à gris brun, 1 mm max., à surface finement chagrinée
Toxicité :
 Plante très toxique Plante très toxique
Nature du toxique : Principalement 3 alcaloïdes, esters de
l'acide troponique, du tropanol ou du scopanol :
• hyoscyamine (en fait la L-hyoscyamine, car lévogyre), qui prédomine
dans le végétal frais
• atropine (racémique de l'hyoscyamine et sans pouvoir rotatoire),
qui prédomine dans le végétal sec et le fruit mûr
• scopolamine également lévogyre.
La plante contient entre 0,3 à 1 % d'alcaloïdes, le groupe hyoscyamine/atropine
en représentant 90 à 95 % et la scopolamine 5 à 10 %.
Organes incriminés : Tous les organes de la plante
renferment des alcaloïdes tropaniques, principalement l'hyoscyamine,
concentrés dans les fruits (0,65 %) et les racines (0,85 %).
L'intoxication est le plus souvent consécutive à l'ingestion de baies,
notamment par des enfants
Symptômes : Les symptômes peuvent apparaître après l'ingestion de 3
baies chez l'enfant et de 10 baies chez l'adulte.
Ils sont est liés aux propriétés antagonistes de l'acétylcholine, se
traduisant par un syndrome anticholinergique.
• Troubles digestifs immédiats avec nausées, vomissements destinés à
éliminer l'agent toxique
• Troubles neurovégétatifs :
- bouche sèche, constipation
- mydriase, troubles de l'accommodation, élévation de la pression
intra-oculaire, diminution de la sécrétion lacrymale
- tachycardie
- risque de rétention urinaire et de glaucome aigu en cas de glaucome à
angle fermé
• En cas d'intoxication aiguë : confusion mentale, hallucinations,
hyperthermie, coma et dépression respiratoire
Remarques :
• La dénomination latine Atropa belladonna provient de
Atropos : déesse grecque qui coupait le fil de la vie, et de
belladonna (belle dame) : à la Renaissance, les belles Italiennes
utilisaient un fard à base d'extrait de belladone entraînant une mydriase
recherchée.
• Les intoxications peuvent être consécutives à la consommation
d'oiseaux ou d'escargots ayant ingérés des baies ou des feuilles de belladone,
contre laquelle ces animaux sont eux-mêmes immunisés.
|
|
|
|
Références bibliographiques
BISMUTH C., 2000. Toxicologie clinique. Éd. Médecine-Sciences - Flammarion.
BLAMEY M., GREY-WILSON C., 1991. La flore d'Europe occidentale. Éd. Arthaud.
BOUDOU-SEBASTIAN C., 2003. Baies et plantes toxiques. Le
moniteur des pharmacies et des laboratoires, cahier II du n°2490.
BOURBIGOT P., 1984. Contribution à l'étude des intoxications par les plantes à
baies ou à fruits bacciformes rouges. Thèse Pharmacie, Lyon I.
BROSSE J., 1995. Les fruits. Bibliothèque de l'image.
BRUNETON J., 2001. Plantes toxiques. Végétaux dangereux pour l'Homme et les
animaux. Éd. Tec et Doc et EMI.
CAJAT M. C., 1992. Plantes ornementales toxiques et intoxications dans la région
de Clermont-Ferrand : cas recensés par le CAP de 1988 à 1990 ; risques pour les
jeunes enfants : enquête réalisée sur les aires de jeu des écoles maternelles.
Thèse Pharmacie, Clermont I.
COUPLAN F., STYNER E., 1994. Guide des plantes comestibles et toxiques. Éd.
Delachaux et Niestlé.
DÄHNCKE R. M., DÄHNCKE
S., 1981. Les baies. Comment déterminer correctement les baies comestibles et
les baies toxiques. Miniguide Nathan.
DEBELMAS A. M., DELAVEAU P., 1983. Guide des plantes dangereuses. Éd. Maloine.
DELAVEAU P., 1974. Plantes agressives et poisons végétaux. Éd. Horizons de
France.
DESCOTES J., TESTUD F., FRANTZ P., 1992. Les urgences en toxicologie. Baies
toxiques (505-511). Autres plantes toxiques (513-523). Éd. Maloine.
ENGEL F., GUILLEMAIN J., 2003. Plantes irritatives et allergisantes
d'appartements et de jardins. Éd. Institut Klorane.
FOURASTE I., 2002. Fruits charnus sauvages et des jardins. Éd. Institut Klorane.
FOURASTE I., 2001. Plantes toxiques sauvages et horticoles. Éd. Institut Klorane.
FROHNE D., PFÄNDER J., 2002. A colour atlas of
poisonous plants. Manson Publishing, Londres.
JEAN-BLAIN C., GRISVARD M., 1973. Plantes vénéneuses. Toxicologie. La Maison
Rustique, Paris.
LAUX H. E. (et GUEDES M.), 1985. Baies et fruits dans nos bois et jardins. Éd.
Bordas.
MEYER F., 1989. Toxicité des baies et des fruits bacciformes. Quinze ans
d'expérience du centre antipoisons de Lyon. Thèse Médecine, Lyon I.
MONDOLOT-COSSON L., 1998. Les plantes toxiques. Le moniteur des pharmacies et
des laboratoires, cahier pratique du n°2259.
Phytoma - La défense des végétaux n°572., 1999. Toxicité des baies en espaces
verts.
Phytoma - La défense des végétaux n°517., 1999. Principales plantes ornementales
à baies toxiques.
REYNAUD J., 2002. La flore du pharmacien. Éd. Tec et Doc et EMI.
SPOERKE D. G. Jr., SMOLINSKE S. C., 1990. Toxicity of houseplants. CRC Presse,
Boston.
THIEVON P. 1992. Développement et première validation d'un système informatique
d'identification des baies. Thèse médecine, Lyon I.
TOUATI A., 1985. Plantes toxiques ornementales. Thèse Pharmacie, Rennes.
TROTIN F., 1975. Plantes toxiques. Diagnose et effets. Un problème de
l'officine. Bulletin de la Société de Pharmacie de Lille n°31 (79-95).
VERMARE D., 1986. Le pouvoir nocif des plantes d'ornement. Thèse Médecine, Lyon
I
|
|
|
|