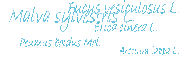|
|

|
Bouillon blanc
|

|
Nom latin : Verbascum thapsus L.
Noms communs : Molène, cierge de Notre-Dame, herbe de
Saint-Fiacre, bonhomme Famille : Scrofulariacées Parties utilisées :
Fleur mondée réduite à la corolle et l'androcée (débarrassée du calice)
Origine : Commun dans toutes les régions d'Europe Centrale,
Occidentale et Orientale, en Asie Mineure, Afrique du Nord et jusqu'en
Éthiopie, le bouillon blanc est très répandu en France. La drogue est
essentiellement issue de cultures et provient d'Égypte, de Bulgarie et de
l'ex-Tchécoslovaquie. La récolte doit être réalisée le matin, par temps
sec, avant épanouissement total des corolles, toute trace d'humidité
pouvant entraîner leur noircissement. Le séchage doit également être
rapidement entrepris.
|
|
|
Description de la drogue sèche (Cahier n°3 de l'Agence du Médicament, 1998) :
• Corolle jaune à 5 pétales soudés à la base, en un tube court s'étalant
en 5 lobes légèrement inégaux habituellement chiffonnés
• Éventuellement : présence d'étamines rattachées à la corolle en
alternance avec les pétales ; 3 sont plus courtes, avec des filets velus ;
2 sont plus longues
Odeur : Douce, rappelant faiblement celle du miel
Saveur : Sucrée et mucilagineuse
Description de la plante à l'état frais :
Herbacée bisannuelle robuste, à tiges raides, plus ou moins ailées, à
pubescence cotonneuse épaisse
Taille : Jusqu'à 2 m, mais souvent moins
Feuilles : Rosette de grandes feuilles basales, blanc grisâtre,
elliptiques à oblongues, émoussées, dentées ou entières, à pétiole étroit,
ailé ; feuilles caulinaires alternes, plus ou moins décurrentes, plus
petites, sessiles
Fleurs : Fleurs jaune d'or, 12-35 mm, en grappes plus ou moins
denses de glomérules ; corolle rotacée de type 5, à pétales inégaux ; 5
étamines, dont 3 courtes, à forte pubescence duveteuse, les 2 autres plus
longues et glabres
Fruits : Capsules globuleuses
Constituants :
• Mucilages : D-galactose, arabinose, D-glucose, D-xylose,
L-rhamnose, D-mannose, L-fucose, acide uronique...
• Iridoïdes : aucuboside, 6β-xylosyl-aucubine,
catalpol, 6β-xylosyl-catalpol, méthylcatalpol, isocatalpol, spécioside
• Saponosides : verbascosaponoside, verbascosaponoside B,
desrhamnosylverbascosaponoside, mulléinesaponoside I à VII
• Hétérosides phényléthanoïdiques : verbascoside (= actéoside)
• Flavonoïdes : dérivés de l'apigénine, de la lutéoline, de la
rutine et du kaempférol
• Autres constituants : lignanes hétérosidiques, acides phénols
(acides caféique, férulique, protocatéchique), stérols, sucres
invertis...
Indications (Cahier n°3 de l'Agence
du Médicament, 1998) :
• Voie orale :
- Traditionnellement utilisé comme traitement adjuvant de la composante douloureuse des troubles fonctionnels digestifs
- Traditionnellement utilisé dans le traitement symptomatique de la toux
• Usage local :
- Traditionnellement utilisé en usage local comme traitement d'appoint adoucissant et antiprurigineux des affections dermatologiques, comme trophique protecteur
- Traditionnellement utilisé par voie locale (collutoire, pastille), comme antalgique dans les affections de la cavité buccale et/ou du pharynx
- Traditionnellement utilisé par voie locale en bain de bouche, pour l'hygiène buccale
Effets indésirables :
Aucun connu à ce jour
Spécialités : Arkogélules bouillon
blanc, Pectoflorine tisane, Tussipax sirop...
|
|
|
|
Références bibliographiques
BEZANGER-BEAUQUESNE L., PINKAS M., TORCK M., TROTIN F., 1990.
Plantes médicinales des régions tempérées. Éd. Maloine.
BEZANGER-BEAUQUESNE L., PINKAS M., TORCK M., 1986. Les plantes dans la
thérapeutique moderne. Éd. Maloine.
BLAMEY M., GREY-WILSON C., 1991. La flore d'Europe occidentale. Éd. Arthaud.
BLUMENTHAL M., BUSSE W. R., GOLDBERG A., GRUENWALD J., HALL T., RIGGINS C. W.,
RISTER R. S., 1998. The complete German Commission E monographs - Therapeutic
guide to herbal medicines. American Botanical Council, Austin, Texas.
BRUNETON J., 2002. Phytothérapie - Les données de l'évaluation. Éd. Tec et Doc et
EMI.
BRUNETON J., 1999. Pharmacognosie - Phytochimie - Plantes médicinales. Éd. Tec
et Doc et EMI.
BRUNETON J., 1987. Éléments de phytochimie et de pharmacognosie. Éd. Techn. Doc.
Lavoisier.
Les Cahiers de l'Agence 3 - Médicaments à base de plantes. 1998. Agence du
Médicament, Paris.
DORVAULT F., 1978. L'officine. Éd. Vigot, Paris.
ESCOP. 1996 - 1997. Monographs on the medicinal uses of plant drugs. ESCOP,
Centre for Complementary Health Studies, University of Exeter, UK.
GARNIER G., BEZANGER-BEAUQUESNE L., DEBRAUX G., 1961. Ressources médicinales de
la flore Française. Éd. Vigot Frères, Paris.
HOSTETTMANN K., 1997. Tout savoir sur le pouvoir des plantes, sources de
médicaments. Éd. Favre, Lausanne.
PELT J. M., 1983. Drogues et plantes magiques. Éd. Fayard, Paris.
Pharmacopée Européenne 1997, 3e édition et
compléments 1998 et 1999. Conseil de l'Europe, Strasbourg.
Pharmacopée Française. Édition en vigueur. Imprimerie Maisonneuve,
Sainte-Ruffine.
Précis de phytothérapie - La santé par les plantes, mode d'emploi. 2003. Éd.
Alpen, Monaco.
ROMBI M., 1991. 100 plantes médicinales. Composition, mode d'action et intérêt
thérapeutique. Éd. Romard, Nice.
SEVENET T., 1994. Plantes, molécules et médicaments. Nathan, CNRS Éditions,
Paris.
Thera - Dictionnaire des médicaments conseil et des produits de parapharmacie. 2004. VIDAL.
WICHTL M., ANTON R., 2003. Plantes thérapeutiques - Tradition, pratique
officinale, science et thérapeutique. Éd. Tec et Doc et EMI. |
|
|
|