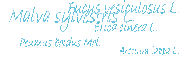|
|

|
Rhubarbe médicinale
|

|
Nom latin : Rheum palmatum var. tanguticum L.
Famille : Polygonacées Parties utilisées :
Organes souterrains
Origine : La rhubarbe est connue en Chine depuis 2700 ans avant
J. C. où elle est déjà mentionnée dans le traité de botanique chinois
("Peu King"). La drogue fournie par l'Asie mineure et utilisée par
Dioscoride, Galien ou Pline était probablement le rhapontic (Rheum
rhaponticum). A partir du XIIe
siècle, la rhubarbe de Chine est massivement importée de Chine via la
Russie, l'Asie Mineure et l'Inde. Rheum officinale est originaire
du nord-ouest de la Chine et de la partie est du Tibet ; elle est
partiellement cultivée en Europe, notamment en France, dans les régions
montagneuses. La drogue provient encore de Chine, de l'Inde et du
Pakistan.
|
|
|
Description de la drogue sèche (Cahier n°3 de l'Agence du Médicament, 1998) :
• Morceaux cylindriques ou plan-convexes ou rondelles épaisses (env. 1-5
cm de diamètre) ou petits fragments de 3-4 mm de côté
• Surface (privée de suber) jaune brun, cassure granuleuse brun-rougeâtre
Odeur : Aromatique très particulière, un peu piquante
Saveur : Un peu amère et âpre
Description de la plante à l'état frais : Plante vivace pérenne et géophyte, à tige florifère haute et robuste, et
munie de souches radicantes renflées en tubercules pouvant atteindre 5 ou
6 kg après 3 ou 4 ans
Taille : Jusqu'à 2 m
Feuilles : Feuilles palmées et lobées devenant remarquablement
grandes ; lobes plus ou moins profondément divisés et dentés ; long
pétiole ; nervures fortement saillantes
Fleurs : Fleurs de type 6, rouge pourpre à blanches, disposées
en racèmes ou en panicules
Fruits : Akènes trigones ailés
Constituants :
• Hétérosides anthraquinoniques : dérivés des 5 aglycones (émodol,
aloe-émodol, rhéine, chrysophanol, physcion)
• Hétérosides dianthroniques : sennosides A à F
• Hétérosides anthroniques : rhéinosides A à D
• Aglycones libres (émodol, aloe-émodol, rhéine, chrysophanol,
physcion)
• Composés phénoliques : galloylglucose, galloylsaccharose
• Phénylbutanones : lindleyine, isolyndléine
• Flavonoïdes : mono- et biosides de flavan-3-ols,
proanthocyanidols dimère et trimères, libres ou estérifiés par l'acide
gallique
• Autres constituants : traces de naphtalènes, stilbènes et de
constituants volatils
Indications (Cahier n°3 de l'Agence
du Médicament, 1998) :
• Voie orale :
- Traditionnellement utilisé chez l'enfant dans les poussées dentaires douloureuses
- Traitement de courte durée de la constipation occasionnelle
Effets indésirables :
Dans de rares cas, des spasmes gastro-intestinaux ont été observés,
surtout chez les patients présentant un côlon irritable, nécessitant alors
une réduction de la dose. Une coloration jaune-brun ou rouge-brun de
l'urine (dépendant du pH) par des métabolites peut survenir, mais sans
signification sur le plan clinique.
En cas d'usage chronique ou d'abus :
- perte en électrolytes, surtout de potassium, pouvant induire des
perturbations des fonctions cardiaques et une faiblesse musculaire,
particulièrement en cas de prise simultanée d'hétérosides cardiotoniques,
de diurétiques et de corticostéroïdes ;
- albuminurie et hématurie ;
- pigmentation non pathogène des muqueuses intestinales (Pseudomelanosis
coli), régressant à l'arrêt du traitement.
Spécialités : Pyralvex solution
buccale...
|
|
|
|
Références bibliographiques
BEZANGER-BEAUQUESNE L., PINKAS M., TORCK M., TROTIN F., 1990.
Plantes médicinales des régions tempérées. Éd. Maloine.
BEZANGER-BEAUQUESNE L., PINKAS M., TORCK M., 1986. Les plantes dans la
thérapeutique moderne. Éd. Maloine.
BLAMEY M., GREY-WILSON C., 1991. La flore d'Europe occidentale. Éd. Arthaud.
BLUMENTHAL M., BUSSE W. R., GOLDBERG A., GRUENWALD J., HALL T., RIGGINS C. W.,
RISTER R. S., 1998. The complete German Commission E monographs - Therapeutic
guide to herbal medicines. American Botanical Council, Austin, Texas.
BRUNETON J., 2002. Phytothérapie - Les données de l'évaluation. Éd. Tec et Doc et
EMI.
BRUNETON J., 1999. Pharmacognosie - Phytochimie - Plantes médicinales. Éd. Tec
et Doc et EMI.
BRUNETON J., 1987. Éléments de phytochimie et de pharmacognosie. Éd. Techn. Doc.
Lavoisier.
Les Cahiers de l'Agence 3 - Médicaments à base de plantes. 1998. Agence du
Médicament, Paris.
DORVAULT F., 1978. L'officine. Éd. Vigot, Paris.
ESCOP. 1996 - 1997. Monographs on the medicinal uses of plant drugs. ESCOP,
Centre for Complementary Health Studies, University of Exeter, UK.
GARNIER G., BEZANGER-BEAUQUESNE L., DEBRAUX G., 1961. Ressources médicinales de
la flore Française. Éd. Vigot Frères, Paris.
HOSTETTMANN K., 1997. Tout savoir sur le pouvoir des plantes, sources de
médicaments. Éd. Favre, Lausanne.
PELT J. M., 1983. Drogues et plantes magiques. Éd. Fayard, Paris.
Pharmacopée Européenne 1997, 3e édition et
compléments 1998 et 1999. Conseil de l'Europe, Strasbourg.
Pharmacopée Française. Édition en vigueur. Imprimerie Maisonneuve,
Sainte-Ruffine.
Précis de phytothérapie - La santé par les plantes, mode d'emploi. 2003. Éd.
Alpen, Monaco.
ROMBI M., 1991. 100 plantes médicinales. Composition, mode d'action et intérêt
thérapeutique. Éd. Romard, Nice.
SEVENET T., 1994. Plantes, molécules et médicaments. Nathan, CNRS Éditions,
Paris.
Thera - Dictionnaire des médicaments conseil et des produits de parapharmacie. 2004. VIDAL.
WICHTL M., ANTON R., 2003. Plantes thérapeutiques - Tradition, pratique
officinale, science et thérapeutique. Éd. Tec et Doc et EMI. |
|
|
|