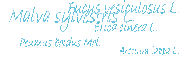|
Références bibliographiques
BEZANGER-BEAUQUESNE L., PINKAS M., TORCK M., TROTIN F., 1990.
Plantes médicinales des régions tempérées. Éd. Maloine.
BEZANGER-BEAUQUESNE L., PINKAS M., TORCK M., 1986. Les plantes dans la
thérapeutique moderne. Éd. Maloine.
BLAMEY M., GREY-WILSON C., 1991. La flore d'Europe occidentale. Éd. Arthaud.
BLUMENTHAL M., BUSSE W. R., GOLDBERG A., GRUENWALD J., HALL T., RIGGINS C. W.,
RISTER R. S., 1998. The complete German Commission E monographs - Therapeutic
guide to herbal medicines. American Botanical Council, Austin, Texas.
BRUNETON J., 2002. Phytothérapie - Les données de l'évaluation. Éd. Tec et Doc et
EMI.
BRUNETON J., 1999. Pharmacognosie - Phytochimie - Plantes médicinales. Éd. Tec
et Doc et EMI.
BRUNETON J., 1987. Éléments de phytochimie et de pharmacognosie. Éd. Techn. Doc.
Lavoisier.
Les Cahiers de l'Agence 3 - Médicaments à base de plantes. 1998. Agence du
Médicament, Paris.
DORVAULT F., 1978. L'officine. Éd. Vigot, Paris.
ESCOP. 1996 - 1997. Monographs on the medicinal uses of plant drugs. ESCOP,
Centre for Complementary Health Studies, University of Exeter, UK.
GARNIER G., BEZANGER-BEAUQUESNE L., DEBRAUX G., 1961. Ressources médicinales de
la flore Française. Éd. Vigot Frères, Paris.
HOSTETTMANN K., 1997. Tout savoir sur le pouvoir des plantes, sources de
médicaments. Éd. Favre, Lausanne.
PELT J. M., 1983. Drogues et plantes magiques. Éd. Fayard, Paris.
Pharmacopée Européenne 1997, 3e édition et
compléments 1998 et 1999. Conseil de l'Europe, Strasbourg.
Pharmacopée Française. Édition en vigueur. Imprimerie Maisonneuve,
Sainte-Ruffine.
Précis de phytothérapie - La santé par les plantes, mode d'emploi. 2003. Éd.
Alpen, Monaco.
ROMBI M., 1991. 100 plantes médicinales. Composition, mode d'action et intérêt
thérapeutique. Éd. Romard, Nice.
SEVENET T., 1994. Plantes, molécules et médicaments. Nathan, CNRS Éditions,
Paris.
Thera - Dictionnaire des médicaments conseil et des produits de parapharmacie. 2004. VIDAL.
WICHTL M., ANTON R., 2003. Plantes thérapeutiques - Tradition, pratique
officinale, science et thérapeutique. Éd. Tec et Doc et EMI. |