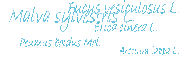|
|

|
Quinquina rouge
|

|
Nom latin : Cinchona pubescens Vahl. Famille :
Rubiacées Partie utilisées : Écorce
Origine : Découvert au Pérou en 1739, le quinquina est spontané
sur le versant oriental de la Cordillère des Andes, entre 1800 et 3000 m
d'altitude. Jusqu'à 1885, cette région a été l'objet d'une récolte intense
par les Cascarilleros, en raison du succès thérapeutique de la poudre
d'écorce. De nos jours, des cultures existent en Asie du Sud-Est, en
Amérique du Sud et en Afrique. La drogue est importée d'Indonésie (Java,
Sumatra), de l'Inde et du Sri Lanka, et partiellement d'Amérique du sud et
d'Afrique (Cameroun, Zaïre, Tanzanie). L'écorce provient surtout d'arbres
âgés entre 10 et 12 ans (écorce des racines, du tronc et des branches).
|
|
|
Description de la drogue sèche (Cahier n°3 de l'Agence du Médicament, 1998) :
• Morceaux d'écorce épais, plus ou moins cintrés (grands fragments) de
2-6mm d'épaisseur, parfois en forme de tuyaux, ou
fragments esquilleux
• Face externe rugueuse, sillonnée et fissurée, gris brun comportant des
lichens
• Face interne brun rouge foncé, nettement striée
• Cassure nettement fibreuse.
Odeur : Légèrement aromatique
Saveur : Amère et astringente
Description de la plante à l'état frais :
Arbre, généralement cultivé de nos jours
Taille : Jusqu'à 20 m
Feuilles : Feuilles opposées, elliptiques, entières, un peu
rougeâtre à la face inférieure, pouvant atteindre 30 cm de long et
accompagnées de stipules concrescentes glanduleuses
Fleurs : Inflorescences terminales portant des fleurs groupées
en grappes ou en corymbes de cymes de couleur rose clair atteignant 2 cm
et entremêlées de petites bractées lancéolées
Graines : Petites graines pourvues d'une aile marginale
denticulée
Constituants :
• Alcaloïdes : quinine et quinidine et leurs homologues déméthoxylés
• Tanins catéchiques et précurseurs de ces tanins : proanthocyanidols di-
et trimères, cinchonaïne
• Saponosides à génine triterpénique dicarboxylique
• Huile essentielle sous forme de traces : α-terpinéol,
linalol, limonène...
• Acides organiques : acide quinique
Indications (Cahier n°3 de l'Agence
du Médicament, 1998) :
• Voie orale :
- Traditionnellement utilisé dans les états fébriles et grippaux
- Traditionnellement utilisé pour stimuler l'appétit
- Traditionnellement utilisé pour faciliter la prise de poids
• Usage local :
- Traditionnellement utilisé dans les démangeaisons et desquamations du cuir chevelu avec pellicules
Effets indésirables :
Occasionnellement, l'absorption de médicaments à base de quinine peut
provoquer des allergies cutanées ou des accès de fièvre. Dans de rares
cas, le risque d'hémorragies est augmenté, en raison de la diminution des
plaquettes sanguines (thrombocytopénie). Consulter immédiatement un
médecin. Une sensibilité à la quinine ou à la quinidine est possible.
Spécialités : Fitofébril solution
buvable...
|
|
|
|
Références bibliographiques
BEZANGER-BEAUQUESNE L., PINKAS M., TORCK M., TROTIN F., 1990.
Plantes médicinales des régions tempérées. Éd. Maloine.
BEZANGER-BEAUQUESNE L., PINKAS M., TORCK M., 1986. Les plantes dans la
thérapeutique moderne. Éd. Maloine.
BLAMEY M., GREY-WILSON C., 1991. La flore d'Europe occidentale. Éd. Arthaud.
BLUMENTHAL M., BUSSE W. R., GOLDBERG A., GRUENWALD J., HALL T., RIGGINS C. W.,
RISTER R. S., 1998. The complete German Commission E monographs - Therapeutic
guide to herbal medicines. American Botanical Council, Austin, Texas.
BRUNETON J., 2002. Phytothérapie - Les données de l'évaluation. Éd. Tec et Doc et
EMI.
BRUNETON J., 1999. Pharmacognosie - Phytochimie - Plantes médicinales. Éd. Tec
et Doc et EMI.
BRUNETON J., 1987. Éléments de phytochimie et de pharmacognosie. Éd. Techn. Doc.
Lavoisier.
Les Cahiers de l'Agence 3 - Médicaments à base de plantes. 1998. Agence du
Médicament, Paris.
DORVAULT F., 1978. L'officine. Éd. Vigot, Paris.
ESCOP. 1996 - 1997. Monographs on the medicinal uses of plant drugs. ESCOP,
Centre for Complementary Health Studies, University of Exeter, UK.
GARNIER G., BEZANGER-BEAUQUESNE L., DEBRAUX G., 1961. Ressources médicinales de
la flore Française. Éd. Vigot Frères, Paris.
HOSTETTMANN K., 1997. Tout savoir sur le pouvoir des plantes, sources de
médicaments. Éd. Favre, Lausanne.
PELT J. M., 1983. Drogues et plantes magiques. Éd. Fayard, Paris.
Pharmacopée Européenne 1997, 3e édition et
compléments 1998 et 1999. Conseil de l'Europe, Strasbourg.
Pharmacopée Française. Édition en vigueur. Imprimerie Maisonneuve,
Sainte-Ruffine.
Précis de phytothérapie - La santé par les plantes, mode d'emploi. 2003. Éd.
Alpen, Monaco.
ROMBI M., 1991. 100 plantes médicinales. Composition, mode d'action et intérêt
thérapeutique. Éd. Romard, Nice.
SEVENET T., 1994. Plantes, molécules et médicaments. Nathan, CNRS Éditions,
Paris.
Thera - Dictionnaire des médicaments conseil et des produits de parapharmacie. 2004. VIDAL.
WICHTL M., ANTON R., 2003. Plantes thérapeutiques - Tradition, pratique
officinale, science et thérapeutique. Éd. Tec et Doc et EMI. |
|
|
|