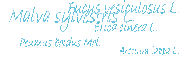|
|

|
Aloès du Cap
|

|
Nom latin : Aloe ferox Miller Famille : Asphodelacées Partie utilisée : Suc
concentré et séché des feuilles
Origine : Connu de la Grèce antique d'où il était importé de
l'île de Socotra, l'aloès est originaire d'Afrique. Aloe vera est
natif d'Afrique du Nord et a été introduit en Amérique. Cette espèce s'est
propagée aux Antilles et sur les côtes du Venezuela. La drogue est surtout
exportée via Curaçao. Les cultures d'Aloe vera sont développées dans
les régions subtropicales des États-unis (Floride, Texas, Arizona).
|
|
|
Description de la drogue sèche (Cahier n°3 de l'Agence du Médicament, 1998) :
• Masses solides d'aspect résineux
• Morceaux plus ou moins gros, noirs, verdâtres, brillants
• Cassure conchoïdale (i.e. courbe avec stries concentriques plus ou moins
nettes), brillante
• Par écrasement : poudre brun verdâtre
Description de la plante à l'état frais :
Plante à port arborescent, xérophile
Taille : 2 à 3 m
Feuilles : Feuilles épaisses et charnues, lancéolées, 15-50 cm,
épineuses sur les deux faces et la marge, réunies en rosette dense au
sommet d'un tronc robuste
Fleurs : Fleurs rouge écarlate en grappes denses portées par une
hampe florale dressée et ramifiée
Constituants :
• Suc :
- Dérivés hydroxyanthracéniques : aloïne A et B (aloïne,
barbaloïne) ; le composé caractéristique de l'aloès du Cap est la 5‑hydroxyaloïne
A
- Fraction résineuse : aloérésines A et B (aloésine) et aloérésine
C en faible quantité
- Hétérosides amers : aloénines A et B, esters méthyliques de
l'acide p-coumarique
• Gel :
- Eau
- Polysaccharides : pectines, hémicellulose
- Acides aminés
- Lipides
- Stérols
- Enzymes
Indications (Cahier n°3 de l'Agence
du Médicament, 1998) :
• Voie orale (suc) :
- Traitement de courte durée de la constipation occasionnelle
• Usage local (gel) :
- Traditionnellement utilisé en usage local comme traitement d'appoint adoucissant et antiprurigineux des affections dermatologiques, comme trophique protecteur
- Traditionnellement utilisé en cas d'érythème solaire, de brûlures superficielles et peu étendues, d'érythèmes fessiers
Effets indésirables :
L'utilisation chronique de laxatifs anthracéniques induit fréquemment
des perturbations de l'équilibre électrolytique avec notamment des pertes
en potassium et aussi en sodium. La perte potassique est à l'origine d'une
paralysie des muscles intestinaux, associée à une diminution de
l'efficacité des laxatifs, entraînant généralement la nécessité
d'augmenter les doses de médicaments. La perte potassique peut également
générer des arythmies, notamment en cas d'association avec des diurétiques
hypokaliémiants. L'utilisation régulière de dérivés anthracéniques altère
la membrane superficielle de l'épithélium et la muqueuse de façon
irrémédiable. Il existe un risque de survenue de spasmes intestinaux,
associés à une perte de mucus.
A haute dose, l'aloès peut provoquer une congestion du petit bassin ainsi
qu'une stimulation réflexe des muscles de l'utérus, pouvant entraîner en
fin de grossesse des avortements ou des accouchements prématurés.
Des doses toxiques d'aloès peuvent provoquer des diarrhées hémorragiques
aiguës et des atteintes rénales pouvant s'avérer fatales. La dose létale
est de 1 g en prise durant plusieurs jours.
L'utilisation de l'aloès doit donc être réglementée de façon très précise
et limitée à l'indication "constipation aiguë".
L'utilisation du gel d'aloès a pu entraîner de rares cas de dermatites
eczémateuses ou d'éruptions papuleuses.
Spécialités : Contre-coups de l'abbé Perdrigeon, Ideolaxyl, Laxilo,
Opobyl, Pilules Carters, Poconéol n°82, Tonilax, Veraskin...
|
|
|
|
Références bibliographiques
BEZANGER-BEAUQUESNE L., PINKAS M., TORCK M., TROTIN F., 1990.
Plantes médicinales des régions tempérées. Éd. Maloine.
BEZANGER-BEAUQUESNE L., PINKAS M., TORCK M., 1986. Les plantes dans la
thérapeutique moderne. Éd. Maloine.
BLAMEY M., GREY-WILSON C., 1991. La flore d'Europe occidentale. Éd. Arthaud.
BLUMENTHAL M., BUSSE W. R., GOLDBERG A., GRUENWALD J., HALL T., RIGGINS C. W.,
RISTER R. S., 1998. The complete German Commission E monographs - Therapeutic
guide to herbal medicines. American Botanical Council, Austin, Texas.
BRUNETON J., 2002. Phytothérapie - Les données de l'évaluation. Éd. Tec et Doc et
EMI.
BRUNETON J., 1999. Pharmacognosie - Phytochimie - Plantes médicinales. Éd. Tec
et Doc et EMI.
BRUNETON J., 1987. Éléments de phytochimie et de pharmacognosie. Éd. Techn. Doc.
Lavoisier.
Les Cahiers de l'Agence 3 - Médicaments à base de plantes. 1998. Agence du
Médicament, Paris.
DORVAULT F., 1978. L'officine. Éd. Vigot, Paris.
ESCOP. 1996 - 1997. Monographs on the medicinal uses of plant drugs. ESCOP,
Centre for Complementary Health Studies, University of Exeter, UK.
GARNIER G., BEZANGER-BEAUQUESNE L., DEBRAUX G., 1961. Ressources médicinales de
la flore Française. Éd. Vigot Frères, Paris.
HOSTETTMANN K., 1997. Tout savoir sur le pouvoir des plantes, sources de
médicaments. Éd. Favre, Lausanne.
PELT J. M., 1983. Drogues et plantes magiques. Éd. Fayard, Paris.
Pharmacopée Européenne 1997, 3e édition et
compléments 1998 et 1999. Conseil de l'Europe, Strasbourg.
Pharmacopée Française. Édition en vigueur. Imprimerie Maisonneuve,
Sainte-Ruffine.
Précis de phytothérapie - La santé par les plantes, mode d'emploi. 2003. Éd.
Alpen, Monaco.
ROMBI M., 1991. 100 plantes médicinales. Composition, mode d'action et intérêt
thérapeutique. Éd. Romard, Nice.
SEVENET T., 1994. Plantes, molécules et médicaments. Nathan, CNRS Éditions,
Paris.
Thera - Dictionnaire des médicaments conseil et des produits de parapharmacie. 2004. VIDAL.
WICHTL M., ANTON R., 2003. Plantes thérapeutiques - Tradition, pratique
officinale, science et thérapeutique. Éd. Tec et Doc et EMI. |
|
|
|